Afrique : un futur de plus en plus urbain ?

Un nouveau rapport consacré à la mobilité éclaire sur les défis liés à l’urbanisation galopante du continent. Et illustre incidemment l’immensité des efforts à réaliser pour les relever.
Dans « Bâtir les villes durables de demain », l’Africa CEO Forum (ACF) et le cabinet de conseil Okan Partners se penchent sur l’un des plus gros casse-tête auxquels sont confrontées les autorités publiques ainsi que les populations africaines : les mobilités urbaines.
Une étude [consultable ici] qui regorge de données, de témoignages et d’exemples édifiants. Elle explore différents challenges clés que le continent devront affronter, alors qu’il accueillera 900 millions de nouveaux urbains sur une durée de trente ans (voir le graphique ci-dessous). C’est une fois et demie leur nombre actuel et une progression de plus de deux fois supérieure à celle enregistrée entre 1990 et 2020.
Pertes de productivité dues aux embouteillages
La sidérante croissance des populations urbaines africaines au cours des trois dernières décennies a déjà entraîné un maelström de difficultés. Comme le souligne le rapport ACF-Okan, alors qu’en moyenne le continent ne compte que 42 voitures pour 1 000 habitants, contre 176 en Amérique latine, il abrite quelques-unes des villes avec les plus forts taux de congestion urbaine au monde. L’étude souligne que, au Ghana, les pertes de productivité dues aux embouteillages représentent jusqu’à 8% du PIB. Cette situation pourrait s’aggraver à l’avenir, avec un nombre de voitures susceptible de doubler, voire de décupler, en Afrique, d’ici à 2050, avertit le rapport.

Plus problématique encore, seulement 5 % des trajets urbains quotidiens en Afrique sont effectués en « transports collectifs institutionnels » (métros, tramways, etc.), contre 10-20 % en Amérique latine et plus de 40% en Europe de l’Est.
Jusqu’à 40 % du budget consacré au transport
Autant d’éléments qui expliquent qu’en proportion du revenu des ménages le transport urbain en Afrique coûte 40 % plus cher que dans le reste du monde.
Répondre aux besoins actuels en infrastructures urbaines est déjà une tâche extrêmement difficile. Les États africains assurent déjà la moitié des investissements nécessaires (45-50 milliards de dollars), mais le déficit de financement est estimé à 30-40 milliards de dollars, selon l’étude.
La situation ne s’arrangera guère sans une métamorphose massive de l’écosystème, alors que la demande de transport urbain à l’horizon 2050 est anticipée à plus de 6 500 milliards de kilomètres-passagers en Afrique subsaharienne. Soit 2,5 fois la demande dans l’Union européenne à cette échéance.
Les prix élevés des transports en Afrique sont dus aux monopoles existant dans le secteur
Pour répondre aux « enjeux majeurs découlant de ces dynamiques structurantes », le rapport préconise six recommandations, couvrant à la fois les phases de planification et de financement, l’utilisation des nouvelles technologies et la question de la « durabilité » des projets, l’impact social et l’utilisation rationnelle des structures existantes.
Rapports de force
Un aspect clé aurait peut-être nécessité une attention plus soutenue : l’économie politique, c’est-à-dire les rapports de force économique entre différents acteurs de l’écosystème des transports sur le continent. « Les prix élevés des transports en Afrique sont dus aux monopoles existant dans le secteur », avertissait en octobre 2019 Shanta Devarajan, ancien économiste en chef de la région Afrique au sein de la Banque mondiale.
L’influence et le pouvoir de nuisance (grèves, blocages…) des réseaux de grands propriétaires de mini-bus (« Gbaka ») à Abidjan n’est pas sans lien avec les difficultés à réformer ce secteur et à développer une offre publique valable, malgré le coût élevé facturé aux populations par ces transporteurs informels. Selon le rapport, les ménages les plus modestes à Abidjan consacrent jusqu’à 40 % de leur budget quotidien au transport.
Les relocalisations de populations nécessaires au développement des infrastructures de transport sont à la fois une source de surcoût, de retard mais aussi de tensions sociales parfois difficiles à contenir, alors que, comme le souligne le rapport, la moitié de la population urbaine du continent vit dans des bidonvilles. Les difficultés du développement du sixième pont de la capitale économique ivoirien et du métro d’Abidjan, par exemple, mais aussi celles rencontrées dans la seconde moitié des années 2010 durant la création du TER de Dakar, illustrent ce challenge.
Le temps politique et économique
Enfin, le rapport estime que le financement de ces infrastructures doit être « majoritairement couvert par des capitaux publics afin d’assurer l’équilibre économique des projets ». Il postule que « l’appréciation du foncier offrira la possibilité d’un bénéfice à plus long terme pour les États et les collectivités locales ».
Mais ces bénéfices risquent de se manifester bien après que les décideurs ayant ordonné ces investissements auront eu l’occasion d’en tirer profit. Comment « actualiser » les bienfaits de ces investissements et, ainsi, encourager les décideurs publics à les réaliser est un point essentiel du problème.
Le « facteur temps » – politique comme économique – est important dans les calculs qui déterminent la réalisation ou non de ces infrastructures. Il se trouve, hélas, que le temps est précisément ce dont les villes africaines disposent le moins.
Le 26/11/2022
Source web par : jeune afrique
Les tags en relation
Les articles en relation

Côte d’Ivoire : une table ronde à Dubaï pour mobiliser 3 milliards $ d’investissements touris
(Agence Ecofin) - Le ministère ivoirien du tourisme et des loisirs va organiser les 20 et 21 octobre 2019, à Dubaï aux Emirats Arabe Unis, une table-ronde ...

Noor Ouarzazate : Masen teste le stockage par batteries
La Moroccan Agency for Sustainable Energy (Masen), en partenariat avec la Banque mondiale via le programme ESMAP, lance un appel à manifestation d’intérêt ...

Maroc : le dessalement de l’eau, pilier stratégique face à la pénurie hydrique
Le marché marocain du dessalement de l’eau de mer connaît une expansion rapide : évalué à 400 millions de dollars en 2024, il atteindra 850 millions d’...

Lutte contre le réchauffement climatique Le Fonds vert pour le climat approuve le financement de 19
Avec ces nouveaux financements au profit des pays en développement, le Fonds vert pour le climat aura approuvé, depuis le début de 2018, 42 nouveaux projets ...

Croissance L’UE revoit ses prévisions à la hausse
D’après les prévisions d’hiver, l'inflation devrait s'orienter à la hausse en 2017 et 2018. Ph : AFP La Commission européenne a revu à la ha...
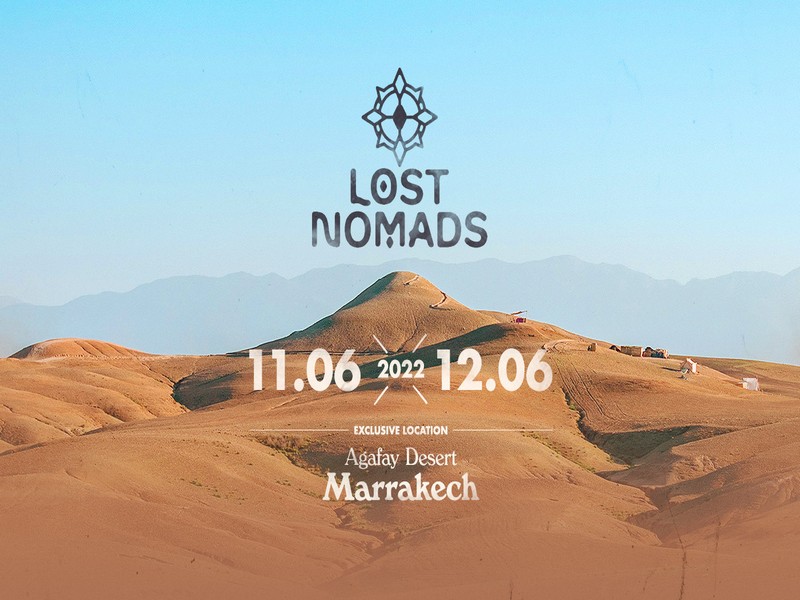
Tous les festivals à Marrakech : choix judicieux ou rush aux fausses opportunités?
- Le nombre de festivals organisés à Marrakech en juin et juillet 2022 a dépassé les records. - Outre les festivals traditionnels, de nouveaux évènemen...

Déclin de l'emploi agricole au Maroc : une réallocation vers des secteurs à faible productivité
Les pertes d'emplois dans l'agriculture, aggravées par la sécheresse, ont principalement profité à des secteurs tertiaires à faible productivité, ...

Banque mondiale : Accélérer le développement pour atténuer les risques climatiques menaçant 1,2
Les risques climatiques sévères tels que les vagues de chaleur, les inondations, les ouragans et les sécheresses menacent aujourd’hui 1,2 milliard de perso...

Le tourisme africain en 2022: les 4 champions et leurs réalisations
Après deux années marquées par le Covid-19, 2022 a marqué le début de la reprise du secteur touristique dans le monde et en Afrique. L’année écoulée, ...
.webp)
Aziz Akhannouch réaffirme l'engagement du Maroc pour un multilatéralisme équitable et inclusif au
Le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, a réaffirmé, lundi à New York, l’engagement résolu du Maroc à mettre en œuvre le Pacte pour l’aveni...

La presse française s’intéresse à l’aide envoyée par le Maroc aux pays africains
Plusieurs médias français se sont fait un large écho de l’envoi par le Maroc, sur hautes instructions du roi Mohammed VI, d’aides médicales à plusieurs...

Extension du port Tanger Med : IFC et MIGA financent l'agrandissement du terminal camions et passage
La Société financière internationale (IFC) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), deux filiales du groupe de la Banque mondiale...


 mardi 29 novembre 2022
mardi 29 novembre 2022 0
0 










































 Découvrir notre région
Découvrir notre région