Lutter contre la désertification et promouvoir la gestion durable des terres

La désertification est souvent comprise -à tort- comme l’extension des déserts existants. Il s’agit en réalité de la dégradation des terres arides mais "non-désertiques" en zones sèches. Pour ces terres, se désertifier signifie perdre leur potentiel biologique, productif et économique sous l’effet notamment de pratiques agricoles inadaptées et des dérèglements climatiques.
Sommaire
- Agir au carrefour de l’environnement et du développement- Les instruments internationaux de lutte contre la désertification
- Que fait la France dans ce cadre ?
Les zones sèches en quelques chiffres
- 40% de la superficie émergée de la planète
- (environ 5 200 millions d’hectares)
- Elles sont réparties sur tous les continents
- 2 milliards d’habitants, parmi les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, notamment des pays africains.
- Une contribution significative à l’offre alimentaire mondiale avec près de 50% des systèmes cultivés sur terre
- Habitat d’une faune et d’une flore sauvage très riche.
- Au niveau mondial 12 millions d’hectares de terres sont dégradés annuellement
La perte des espèces et services écosystémiques de ces terres représenterait 10% du PIB mondial annuel.
Agir au carrefour de l’environnement et du développement
En 2019, le GIEC rappelait que les terres jouent un rôle clef dans le système climatique.
Les émissions de gaz à effet de serre issues en particulier de l’agriculture, de la déforestation et de la dégradation des écosystèmes forestiers sont responsables de 23% du total mondial des émissions d’origine humaine.
Dans le même temps, les processus naturels des terres absorbent l’équivalent d’1/3 des émissions de CO2 des énergies fossiles et de l’industrie.
L’IPBES, plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques estime que restaurer 350 millions d’hectares de terres dégradées d’ici à 2030 pourrait générer l’équivalent de 9 000 milliards de dollars de services écosystémiques et absorber 13 à 26 gigatonnes de gaz à effet de serre.
Le phénomène de dégradation des terres constitue un enjeu majeur pour le développement durable et a de nombreuses conséquences environnementales et socio-économiques :
- appauvrissement de la biodiversité,
- diminution de la capacité de stockage du carbone dans les sols,
- raréfaction des ressources en eau
- pauvreté et insécurité alimentaire,
- inégalités d’accès aux ressources naturelles,
- déstabilisation des sociétés,
- migrations,
- conflits.
Depuis 2012, la neutralité en matière de dégradation des terres fait l’objet de la cible 15.3 des Objectifs de Développement Durable. Il s’agit, d’ici à 2030, de lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols.
Les instruments internationaux de lutte contre la désertification
La convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD ou UNCCD en anglais), adoptée à Paris en 1994, est l’une des 3 conventions de Rio, au même titre que celle portant sur les changements climatiques et celle sur la diversité biologique.
La CNULCD est née de la mobilisation des pays en développement face à l’insuffisance des deux autres conventions de Rio pour traiter des enjeux qui leur étaient propres. Elle traite principalement de la conservation, gestion durable et restauration des terres et constitue un pont entre environnement et développement, et entre climat, biodiversité, et sécurité alimentaire. Cette convention est entrée en vigueur en 1996 et compte 197 Parties (196 États et l’Union européenne). La 14ème session de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification s’est tenue à New Delhi du 1er au 13 septembre 2019.
L’Observatoire du Sahara et du Sahel
L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) est une organisation à vocation régionale créée en 1992.et a pour particularité d’être transsaharienne. Elle regroupe :
- 25 États africains (Afrique du Nord, de l’Ouest, de l’Est et Afrique centrale),
- 7 États du Nord (Allemagne, Belgique Canada, Italie, France, Luxembourg, Suisse),
- 7 organisations sous-régionales africaines,
- 4 organisations onusiennes,
- 3 ONG.
- L’OSS intervient dans la zone saharienne et alentours en traitant de façon transversale les problèmes environnementaux (eau, terres, climat). Il peut s’agir de travaux de recherche scientifiques et techniques sur la gestion durable des ressources naturelles, de partage de connaissances, d’actions de communication ou encore de la définition et du suivi-évaluation de projets sur la lutte contre la sécheresse, la désertification et la gestion des ressources. La France en assure la vice-présidence et lui apporte un soutien technique et financier. L’OSS est accrédité au Fonds vert pour le Climat depuis octobre 2017.
Que fait la France dans ce cadre ?
Les sols jouent un rôle crucial pour la sécurité alimentaire mondiale, l’adaptation des populations au dérèglement climatique et la séquestration de carbone.
A ce titre, la France a lancé, le 1er décembre 2015, lors de la 21ème conférence des Parties de la convention cadre des nations Unies sur les changements climatiques (COP21), l’initiative « 4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat ».
L’initiative « 4 pour 1000 » a été reconnue comme solution agricole innovante pour contribuer à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre et à l’adaptation, avant 2020 et sur le long terme, dans le cadre du Plan d’action Lima Paris (LPAA). Elle vise à montrer que l’agriculture, et en particulier les sols agricoles, peuvent jouer un rôle crucial pour la sécurité alimentaire et le changement climatique. On parle de "4 pour 1000" car un taux de croissance annuel de 0,4% (ou 4‰) des stocks de carbone du sol, dans les premiers 30 à 40 cm de sol, réduirait de manière significative dans l’atmosphère la concentration de CO2 liée aux activités humaines.
L’agro-écologie, pilier central de l’engagement la France
L’agro-écologie constitue un pilier central de l’engagement la France auprès des États africains notamment Sahéliens. Cette approche permet de restaurer le potentiel de stockage de carbone des sols. Elle joue aussi un rôle d’adaptation au changement climatique, de conservation ou restauration de la biodiversité, de gestion durable des ressources en eau, de lutte contre l’insécurité alimentaire, de stimulation des économies locales et de création d’emplois durables.
La France a ainsi mobilisé 235 M€ (2013-2018) sur l’agro-écologie via l’AFD et soutient la recherche africaine sur ces sujets, grâce aux programmes du CIRAD et de l’IRD.
Dans ce cadre, la France a initié fin 2017 une Initiative verte pour le Sahel, pour développer les pratiques agro-écologiques dans la région à travers la diffusion d’un plaidoyer auprès des acteurs africains et internationaux de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de l’environnement, en se coordonnant aux divers agendas internationaux (COPs des Conventions de Rio, Alliance Sahel, G5 Sahel, G7, G20, et Sommets internationaux).
Appui à la CNULCD
La France appuie la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD) et soutient techniquement et financièrement son secrétariat exécutif. Il s’agit d’un axe fort et constant de la politique de coopération française en matière d’environnement et de développement durable. En tant que 5e contributeur financier, sa participation pour la période 2020-2021 est de 665 000€.
Soutien financier aux pays en développement
Fortement impliquée dans la mise en œuvre de la Convention dans les pays en développement, les engagements financiers bilatéraux français en matière de lutte contre la désertification et la dégradation des terres s’élevaient en 2016 à 381 M€ dont 166 M€ en Afrique.
Ces engagements se traduisent principalement par le financement par l’Agence française de développement (AFD) et le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) de projets dans les domaines de la gestion intégrée des ressources naturelles et foncières, de l’amélioration des systèmes de production agricole et d’élevage, de la gestion durable de l’eau agricole et des forêts, ou de la surveillance environnementale.
Des priorités définies par un document cadre
La France s’est dotée en 2006 d’un document d’orientation stratégique, fixant ses priorités en matière de lutte contre la désertification/dégradation des terres, dans le cadre de sa politique d’appui au développement et à l’environnement. L’objectif central est de favoriser la mise en œuvre d’actions au bénéfice direct des populations touchées, principalement dans la zone soudano-sahélienne et dans le Maghreb. Ce document fait actuellement l’objet d’une mise à jour, en concertation avec l’ensemble des acteurs et opérateurs français concernés, et sera publié en juin 2020.
Des partenaires scientifiques privilégiés
Le Comité scientifique français de la désertification (CSFD) et le Groupe de travail désertification (GTD) sont des partenaires privilégiés des institutions publiques pour la mise en œuvre de cette stratégie. Le CSFD est engagé dans la mobilisation des scientifiques et des experts français et francophones dans tous les débats internationaux pour faire émerger les thématiques de lutte contre la désertification et favoriser la diffusion des connaissances. Le GTD, animé par le Centre d’actions et des réalisations internationales (CARI), contribue notamment à la sensibilisation de l’opinion publique française, des organisations de solidarité internationale et des collectivités locales, aux enjeux de la lutte contre la désertification.
Source web Par : diplomatie
Les tags en relation
Les articles en relation

Hydrogène vert : L’Algérie veut concurrencer le Maroc
L’Algérie veut se positionner comme l’exportateur principal d'hydrogène vert vers le marché européen. Les responsables multiplient les déclarations...

Vision Agricole 2050 : le Maroc face aux défis climatiques
Le Maroc prépare l’avenir de son agriculture avec le lancement, dès novembre, d’une étude stratégique baptisée « Vision Agricole 2050 », dotée d’u...

Finance pour le climat : les ONG pressent le G20 d’accélérer les réformes
«Le temps presse». C’est le cri d’alarme lancé par plusieurs ONG internationales qui ont appelé ce mercredi les dirigeants du G20 à «accélérer» la ...
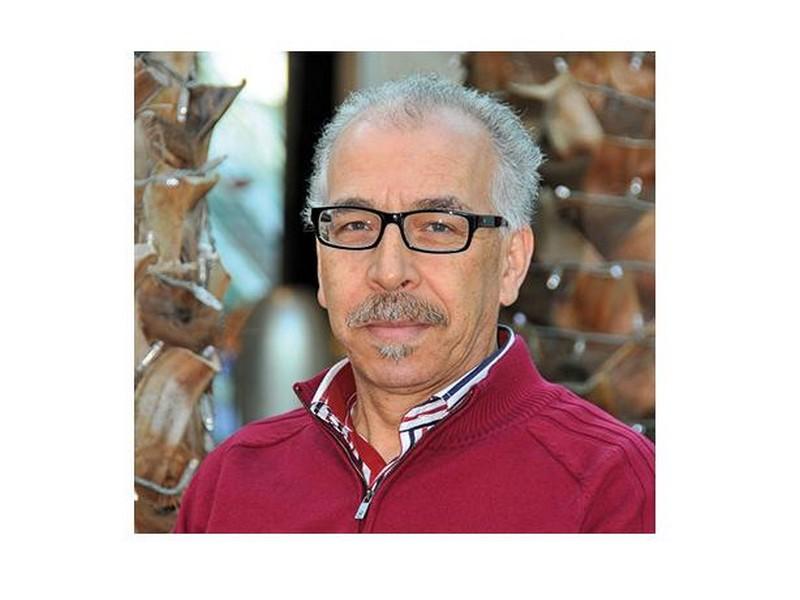
Les 100 milliards de la COP22 : le « bluff » du siècle ?
" L'analyse selon laquelle cette promesse [ndlr. des 100 milliards de dollars de financements] est avant tout destinée à « faire patienter » l'Afriq...

Marrakech Une centrale de réservation pour la COP22
Hassad et Haddad se concertent avec les hôteliers et les voyagistes Connexions modernes et des conditions de vente uniformes, les priorités Mohamed Hass...
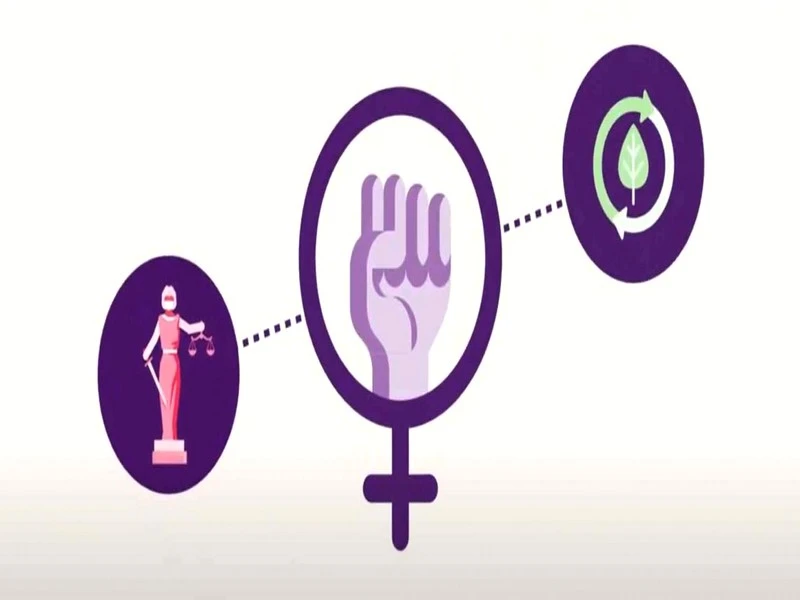
LE DÉVELOPPEMENT FÉMINISTE, PARCE QUE C’EST PLUS EFFICACE
Pendant la Journée internationale des droits des femmes comme le reste de l’année, le groupe AFD s’affirme comme féministe. En choisissant d’inscrire l...

Sécurité hydrique : le warning du président de la région de Casablanca
La sécurité hydrique dans la région Casablanca-Settat représente une préoccupation immédiate et un défi collectif, a indiqué, mardi à Meknès, le prés...

COP22: Miriem Bensalah réaffirme à Londres l'engagement de la CGEM dans la lutte contre le réchau
Mme Miriem Bensalah-Chaqroun, présidente de la CGEM, a réaffirmé à Londres l'engagement fort du secteur privé dans la lutte contre le réchauffement cl...

OCP Maroc : 130 Mds pour une production verte d’ici 2027
Le Groupe OCP, leader mondial des phosphates et des fertilisants phosphatés, représente environ 6 % du PIB du Maroc en 2024. Fort de 70 % des réserves mondia...

Masen : programme africain pour les énergies renouvelables
Masen, en collaboration avec plusieurs institutions internationales dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la GIZ, l’AFD et l’IRENA...

Hydrogène Vert au Maroc : Centrale Solaire et Éolienne à Guelmim en 2026
Le Maroc met en place un projet pilote ambitieux de production d’hydrogène vert, dont le lancement est prévu pour 2026. Ce projet, développé dans la régi...

Salaheddine Mezouar: le Maroc fortement mobilisé pour la transition énergétique
Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Salaheddine Mezouar, a affirmé mercredi que l'accord de Paris est le résultat d'une prise...


 jeudi 24 juin 2021
jeudi 24 juin 2021 0
0 










































 Découvrir notre région
Découvrir notre région