La déroute de l’intelligentsia

Les Américains n’ont pas seulement élu un président sans expérience politique : ils ont également ignoré l’avis de l’écrasante majorité des journalistes, des artistes, des experts, des universitaires. Le choix en faveur de M. Donald Trump étant souvent lié au niveau d’instruction des électeurs, certains démocrates reprochent à leurs concitoyens de ne pas être assez cultivés.
The Estate of Philip Guston - Hauser & Wirth, Zürich, London, New York
Il existe un pays au moins où les élections ont des effets rapides. Depuis la victoire de M. Donald Trump, le peso mexicain s’écroule, le coût des prêts immobiliers s’élève en France, la Commission européenne desserre l’étau budgétaire, les sondeurs et les adeptes du microciblage électoral rasent les murs, le peu de crédit accordé aux journalistes agonise, le Japon se sent encouragé à réarmer, Israël attend le déménagement de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, et le partenariat transpacifique est mort.
Ce tourbillon d’événements et de conjectures suscite une rêverie mêlée d’inquiétude : si un homme presque universellement décrit comme incompétent et vulgaire a pu devenir président des États-Unis, c’est que, désormais, tout est possible. Une contagion du scrutin américain paraît même d’autant plus concevable que son issue imprévue a été remarquée dans le monde entier, et pas seulement par les experts en politique étrangère.
Depuis une dizaine d’années, on ne compte plus les surprises électorales de ce genre, presque toujours suivies par trois jours de repentance des dirigeants mis en accusation, puis par la reprise placide des politiques désavouées. La persistance d’un tel malentendu — ou la répétition d’un tel simulacre — se comprend d’autant mieux que la plupart des électeurs protestataires résident souvent fort loin des grands centres de pouvoir économique, financier, mais aussi artistique, médiatique, universitaire. New York et San Francisco viennent de plébisciter Mme Hillary Clinton ; Londres s’est prononcé massivement contre le « Brexit » en juin dernier ; il y a deux ans, Paris reconduisait sa municipalité de gauche à l’issue d’un scrutin national triomphal pour la droite. Autant dire que, sitôt l’élection passée, il est loisible aux gens heureux de continuer à gouverner dans un entre-soi émollient, toujours aussi attentifs aux recommandations de la presse et de la Commission européenne, toujours aussi prompts à imputer aux révoltés des urnes des carences psychologiques ou culturelles qui disqualifient leur colère : ils ne seraient au fond que des demeurés manipulés par des démagogues.
Ce type de perception est ancien, en particulier dans les cénacles cultivés. Au point que l’analyse de la « personnalité autoritaire » de l’électeur populaire de M. Trump menée depuis des mois ressemble au portrait psychologique que les gardiens de l’ordre intellectuel dressaient des « subversifs » de droite comme de gauche pendant la guerre froide.
Analysant la prévalence de ces derniers dans le monde ouvrier plutôt qu’au sein des classes moyennes, le politiste américain Seymour Martin Lipset concluait en 1960 : « En résumé, une personne issue des milieux populaires est susceptible d’avoir été exposée à des punitions, à une absence d’amour et à une atmosphère générale de tension et d’agressivité depuis l’enfance qui tendent à produire des sentiments profonds d’hostilité, lesquels s’expriment sous la forme de préjugés ethniques, d’autoritarisme politique et de foi religieuse millénariste (1). »
En avril 2008, huit ans avant que Mme Clinton ne consigne la plupart des soixante-deux millions d’électeurs de M. Trump dans le « panier des gens déplorables », M. Barack Obama avait attribué le paradoxe du vote républicain en milieu populaire au fait que des gens votent contre leur intérêt quand, « pour exprimer leur frustration, ils s’accrochent à leurs fusils ou à leur religion, ou à une forme d’antipathie envers ceux qui ne sont pas comme eux, ou à un sentiment hostile aux immigrés ou au commerce international ». Frustration contre raison : les gens instruits, souvent convaincus de la rationalité de leurs préférences, sont souvent décontenancés par les philistins qui s’en défient.
Rien ne rend mieux compte de ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait le « racisme de l’intelligence (2) » — de plus en plus prégnant chez les néolibéraux de gauche, mais aussi chez nombre d’intellectuels et d’universitaires radicaux — qu’un commentaire de l’élection américaine paru sur le site de la prestigieuse revue Foreign Policy. À supposer que le titre — « Trump a gagné parce que ses électeurs sont ignorants, vraiment » — n’en dévoile pas instantanément le propos, un résumé de deux lignes lève les doutes : « La démocratie a pour vocation de mettre en œuvre la volonté populaire. Mais qu’en est-il si le peuple ne sait pas ce qu’il fait (3) ? »
Comme il se doit, une batterie de chiffres et de réflexions puissantes appuie l’argumentation. L’auteur, Jason Brennan, un professeur de philosophie, attaque très fort : « Eh bien, c’est arrivé. Donald Trump a toujours bénéficié de l’appui massif des Blancs peu instruits et mal informés. Un sondage de Bloomberg Politics indiquait qu’en août Hillary Clinton disposait d’une avance massive de 25 % auprès des électeurs de niveau universitaire. Par contraste, lors de l’élection de 2012, ceux-ci favorisaient de justesse Barack Obama plutôt que Mitt Romney. La nuit dernière, nous avons vécu quelque chose d’historique : la danse des ânes. Jamais auparavant les gens instruits n’avaient aussi uniformément rejeté un candidat. Jamais auparavant les gens moins instruits n’en avaient aussi uniformément appuyé un autre. »
Brennan se montre davantage galvanisé que sonné par un constat qui le conforte dans son credo antidémocratique. Adossé à « plus de soixante-cinq ans » d’études conduites par des chercheurs en sciences politiques, il a en effet déjà acquis la certitude que la « terrifiante » absence de connaissances de la plupart des électeurs disqualifie leur choix : « Ils savent en général qui est le président, mais guère plus. Ils ignorent quel parti contrôle le Congrès, ce que le Congrès a fait récemment, si l’économie se porte mieux ou plus mal. »
Néanmoins, certains s’appliquent davantage que d’autres. Républicains ou démocrates, ils sont aussi les plus diplômés. Et, par le plus heureux des hasards, les gens cultivés se montrent plutôt favorables, comme le libertarien Brennan, au libre-échange, à l’immigration, à une réduction des déficits, aux droits des homosexuels, à la réforme — progressiste — du système pénal et à celle — conservatrice — de l’État-providence. Autant dire que si l’information, l’éducation et l’intelligence l’avaient emporté le 8 novembre, un individu aussi grossier et aussi peu soucieux de s’instruire que M. Trump, « dont le programme, hostile au commerce international et à l’immigration, s’oppose au consensus des économistes de gauche, de droite et du centre », ne s’apprêterait pas à quitter son triplex de New York pour le bureau ovale de la Maison Blanche. Lors d’un de ses meetings, le milliardaire s’était d’ailleurs exclamé : « J’aime les gens peu instruits. »
La sanction du discours identitaire et bourgeois de la candidate démocrate
À quoi bon soulever une objection, signaler par exemple que M. Obama, qui enseigna le droit à l’université de Chicago, fut néanmoins élu et réélu grâce au vote de millions d’individus peu ou pas diplômés, que nombre de brillants esprits frais émoulus de Harvard, Stanford, Yale ont successivement pensé la guerre du Vietnam, préparé l’invasion de l’Irak, créé les conditions de la crise financière du siècle (4) ? Au fond, une analyse du scrutin américain conduisant à se défier du manque de jugement du peuple a pour principal intérêt de refléter l’humeur du temps, et pour principal avantage de conforter le sentiment de supériorité de la personne forcément cultivée qui la lira. Mais elle comporte un risque politique : en temps de crise, le « racisme de l’intelligence », qui entend privilégier le règne de la méritocratie, des gens bien éduqués, des experts, fait souvent le lit des hommes à poigne, plus soucieux d’embrigadement que d’instruction.
La plupart des commentateurs ont choisi de braquer les projecteurs sur la dimension raciste et sexiste du scrutin. Au fond, peu leur importe que, en dépit du caractère historique de la candidature de Mme Clinton, l’écart entre le vote des hommes et des femmes ait à peine progressé et que celui, abyssal, entre électeurs blancs et noirs ait, lui, légèrement régressé (lire Jerome Karabel, « Comment perdre une élection »). Le cinéaste Michael Moore, qui avait prévu la victoire de M. Trump, n’a pas manqué de relever la chose sur MSNBC le 11 novembre : « Vous devez accepter que des millions de gens qui avaient voté pour Barack Obama ont cette fois changé d’avis. Ils ne sont pas racistes. »
Noir, progressiste, musulman, représentant du Minnesota, M. Keith Ellison a aussitôt prolongé cette analyse, insistant sur les mobiles économiques du scrutin et la défiance que suscitait une candidate trop proche de l’establishment, trop urbaine, trop hautaine : « Nous n’avons pas obtenu un bon résultat auprès des Latinos et des Afro-Américains. Par conséquent, cette vision qui voudrait tout imputer à la classe ouvrière blanche est erronée (5). » M. Ellison fut l’un des très rares parlementaires à soutenir M. Bernie Sanders lors des primaires ; il est désormais, avec son appui, candidat à la direction de son parti. S’adressant à ses partisans étudiants, le héraut de la gauche démocrate vient pour sa part de réclamer que ceux qui ont choisi Mme Clinton comme porte-drapeau aillent « au-delà des politiques identitaires ». Et il a ajouté : « Il ne suffit pas de dire à quelqu’un : “Je suis une femme, votez pour moi.” Non, ça ne suffit pas. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une femme qui aura le courage de s’opposer à Wall Street, aux compagnies d’assurances, à l’industrie des énergies fossiles. » L’université américaine étant l’un des lieux où le souci de la diversité l’emporte volontiers sur celui de l’égalité et où les préjugés culturels ne sont pas moins nombreux qu’ailleurs, mais inversés, M. Sanders ne prêcha pas forcément des convaincus ce jour-là.

Philip Guston. – « Red Box » (Boîte rouge), 1977
Cependant, rien n’y fait : pour bien des démocrates, chacun appartient à un groupe unique, lequel n’est jamais économique. Par conséquent, si des Noirs ont voté contre Mme Clinton, c’est qu’ils étaient misogynes ; si des Blanches ont voté pour M. Trump, c’est qu’elles étaient racistes. L’idée que les premiers peuvent être aussi des sidérurgistes sensibles au discours protectionniste du candidat républicain et les secondes des contribuables cossues attentives à ses promesses de réduction d’impôts ne semble guère pouvoir s’immiscer dans leur univers mental.
Cette année, le niveau d’instruction et de revenu a pourtant davantage déterminé le résultat que le sexe ou la couleur de peau, puisque c’est la variable qui a le plus évolué d’un scrutin à l’autre. Dans le groupe des Blancs sans diplôme, l’avantage des républicains était déjà de 25 % il y a quatre ans ; il vient d’atteindre 39 % (6). Jusqu’à une date récente, un démocrate ne pouvait être élu sans eux. Au motif que leur proportion dans la population américaine décline (7), que leur encadrement syndical se défait et qu’ils voteraient de plus en plus « mal », certains démocrates, dont l’insistance sur le thème de la diversité résume la stratégie, s’accommoderont-ils désormais de l’idée de devoir être élus contre eux ?
Ce défi politique ne se présente pas seulement aux États-Unis. Évoquant ses étudiants des deux rives de l’Atlantique, l’historien italien Enzo Traverso témoigne : « Personne ne dirait jamais qu’il vote Trump. Tous tiennent à peu près le même discours : “Nous sommes cultivés, respectables, intelligents — et riches ; les autres, en face, sont des ploucs, ‘affreux, sales et méchants’”, pour reprendre le titre d’un célèbre film italien. Or c’était autrefois le discours des nationalistes contre les classes populaires (8). »
Mais, pour gourmander utilement les « ploucs », mieux vaudrait que leurs censeurs disposent de quelque crédit auprès d’eux. Or plus ils s’enferment dans des discours abstraits et opaques, plus ils s’enfoncent dans un verbalisme radical-chic, moins ils se font entendre de l’Amérique tranquille des petites villes ou de celle des comtés dévastés, où le taux de suicide augmente et où l’on se soucie avant tout de ses conditions d’existence.
Résultat : la droite est parvenue à transformer l’anti-intellectualisme en arme politique efficace, en identité culturelle revendiquée (9). En 2002, dans un texte largement diffusé, les républicains, qui « voient rouge » (la couleur qui leur est associée sur les cartes électorales), retournent à leur avantage le stigmate du « plouc » : « La plupart des habitants de l’Amérique rouge ne savent pas déconstruire la littérature postmoderne, donner les instructions qu’il faut à une gouvernante, choisir un cabernet au goût de réglisse. Mais nous savons élever nos enfants, câbler nos maisons, parler de Dieu avec aisance et simplicité, réparer un moteur, utiliser un fusil ou une scie électrique, cultiver des asperges, vivre tranquilles sans système de sécurité ni psychanalyste (10). »
La plupart des habitants de l’Amérique rouge ne lisent pas non plus la presse, que M. Trump a jugée « tordue », « corrompue », « malhonnête », et qu’il a fait huer lors de ses meetings. Puisqu’il avait menti comme un arracheur de dents tout au long de sa campagne, le candidat républicain méritait d’être souvent démenti par les journalistes. Mais, outre que la vérité ne constitue pas la production la plus universelle de la presse américaine, ni la plus lucrative, l’engagement des médias en faveur de Mme Clinton et leur incompréhension des électeurs de M. Trump résultent là encore d’un enfermement social et culturel. L’éditorialiste du New York Times Nicholas Kristof s’en expliquait le 17 novembre sur Fox News entre deux conférences rémunérées 30 000 dollars l’unité : « Le problème du journalisme est qu’il favorise toutes sortes de diversités aux dépens de la diversité économique. Nous ne comptons pas assez de gens issus des communautés ouvrières et rurales. » Ce biais sociologique ayant été documenté et commenté aux États-Unis depuis un quart de siècle, gageons que sur ce point le changement n’est pas pour demain.
Mais, dorénavant, les candidats « hors système » n’hésitent pas à se prévaloir de la haine qu’ils inspirent aux médias. En Italie, M. Giuseppe (« Beppe ») Grillo a ainsi tiré de l’élection américaine une leçon réconfortante pour lui et son parti : « Ils prétendent que nous sommes sexistes, homophobes, démagogues et populistes. Ils ne réalisent pas que des millions de gens ne lisent plus leurs journaux et ne regardent plus leur télévision (11). »
Le lieu de l’échec de Hillary Clinton est précisément situé
Certains le réalisent enfin. Le 10 novembre, sur France Inter, Frédéric Beigbeder, ancien publicitaire devenu écrivain et journaliste, admettait avec une désarmante lucidité sa perte d’influence et celle de ses congénères : « La semaine dernière, j’expliquais, avec toute l’assurance des ignares, que Donald Trump allait perdre l’élection présidentielle américaine. (…) Aucun intellectuel n’a rien pu écrire pour empêcher sa victoire. (…) Le gouvernement du peuple par le peuple est le seul système dans lequel j’aie envie de vivre, mais au fond, qu’est-ce que je connais du peuple ? Je vis à Paris, puis là je suis à Genève ; je fréquente des écrivains, des journalistes, des cinéastes. Je vis complètement déconnecté de la souffrance du peuple. Ce n’est pas une autocritique, c’est un simple constat sociologique. Je sillonne le pays, mais les gens que je rencontre s’intéressent à la culture — une minorité d’intellectuels non représentatifs de la révolte profonde du pays. »
La Californie a voté massivement pour Mme Clinton, qui y a réalisé des scores spectaculaires auprès des populations diplômées des comtés les plus prospères, souvent presque entièrement blancs. Révulsés par le résultat national, certains habitants réclament une sécession de leur État, un « Calexit ». M. Gavin Newsom, gouverneur adjoint de Californie et ancien maire de San Francisco, ville où M. Trump n’a obtenu que 9,78 % des suffrages, ne partage pas leur avis. Mais il entend déjà combattre les politiques du nouveau président en se rapprochant des « dirigeants éclairés » du monde occidental. Il ne lui reste plus qu’à les trouver.
Le 24 Janvier 2017
SOURCE WEB Par Monde-Diplomatique
Les tags en relation
Les articles en relation

#USA_SAHARA_MOHAMMEDVI: UN COUP ROYAL !
L’annonce de la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur la Saquiat Al Hamra et le Wadi Eddahab, nos provinces sahariennes, par les Etats-Un...

Le message du roi Mohammed VI à Trump
Le roi Mohammed VI a adressé un message au président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépe...

Les exigences de Mohammed Ben Salmane pour intégrer les Accords d’Abraham
Un programme nucléaire civil, la levée des restrictions sur les achats d’armes américaines, des garanties de sécurité… Selon le New York Times, l’Ara...

Un ancien général du KGB lié au «dossier compromettant» sur Trump retrouvé mort
RUSSIE Le document en question, à l’authenticité non vérifiée, fait état d’une sextape de Donald Trump avec des prostituées russes… Il pourrait s...

Crise en Ukraine : Réunion clé des dirigeants européens à Paris
Bas du formulaireLes dirigeants européens se réunissent ce lundi 17 février à Paris afin de définir une position commune face aux récentes initiatives de ...

Trump et le Sahara marocain : vers une reconnaissance accélérée ?
Le retour de Trump, un catalyseur pour la reconnaissance du Sahara marocain ? Un rapport de la Fondation Carnegie pour la paix internationale suggère que le...

Le difficile chantier de réforme de l’Organisation mondiale du commerce
Critiquée de toutes parts, l’OMC traverse depuis des années une crise existentielle qui s’est encore aggravée ces derniers mois avec les attaques en règ...

Trump allège les taxes, les Bourses asiatiques bondissen
Les marchés boursiers asiatiques ont connu une envolée jeudi à la suite de l’annonce surprise de Donald Trump concernant un gel temporaire des nouveaux dro...

États-Unis : Trump signe un nouveau décret migratoire ciblant 12 pays
Le président américain Donald Trump a signé un nouveau décret migratoire, interdisant l’entrée aux États-Unis aux ressortissants de 12 pays à compter d...

Tourisme: les recettes en hausse et les arrivées stagnent au 1er trimestre 2016
Les recettes touristiques ont progressé de 6,6%, malgré une stagnation des arrivées (-0,5%) et des nuitées (-0,9%) au premier trimestre 2016. Dans ses de...

Nasrallah Belkhayate : « Il est temps d’adopter la « Diplomatie Twitter » !
A l’issue des travaux du Conseil et conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution, et sur proposition du Chef du gouvernement et à l’...

L'Accord de Paris sur le climat pourrait entrer en vigueur après la COP22 à Marrakech
Huit mois après son adoption à Paris par 195 pays, l'accord "historique" pour lutter contre le réchauffement de la planète est en cours de ratification:...
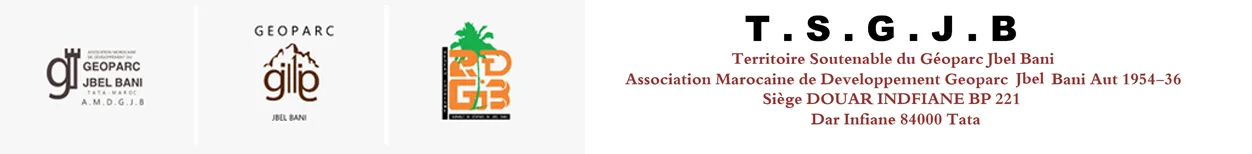

 vendredi 27 janvier 2017
vendredi 27 janvier 2017 0
0 



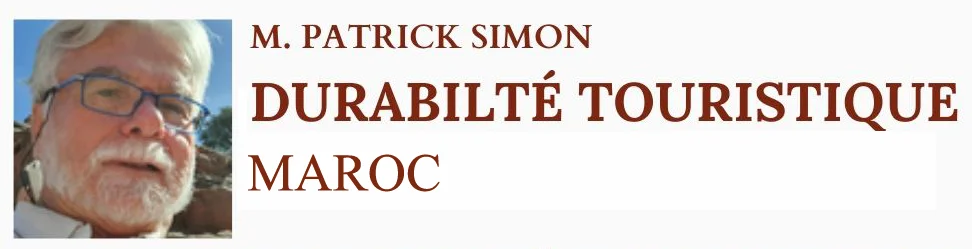







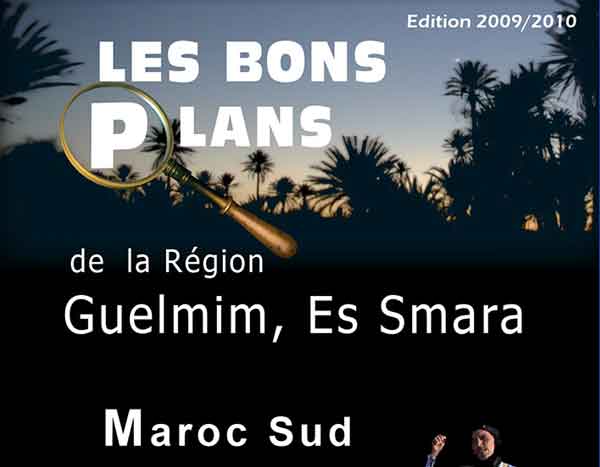






























 Découvrir notre région
Découvrir notre région