Classes moyennes rurales: une étude décrypte les caractéristiques et les enjeux de son émergence

Dans une étude pionnière, l'Institut Royal des Études Stratégiques (IRES) décrypte les caractéristiques des classes moyennes rurales au Maroc. Une nébuleuse à explorer…
C’est une étude sur les classes moyennes rurales qui va particulièrement résonner au Maroc, dans un contexte marqué par un modèle de développement que le pays aspire à réaliser, et une volonté royale de promouvoir l’émergence d’une classe moyenne agricole ainsi que la création de nouvelles activités génératrices d’emplois et de revenus, notamment en faveur des jeunes.
Cette étude a été présentée récemment au sein de l’IRES. Elle a eu pour objet non seulement d’identifier la classe moyenne rurale, ses caractéristiques et ses enjeux, d’analyser les politiques publiques mises en œuvre et leurs retombées sur l’émergence de cette classe, mais aussi de formuler une alternative pour un développement durable d’une classe moyenne rurale (CMR).
Les classes moyennes rurales : un « S » qui en dit beaucoup
L’étude souligne d’emblée l’ambivalence de l’expression « classe moyenne rurale » ; une expression généralement utilisée pour évoquer des groupes sociaux qui n’appartiennent ni aux classes les moins favorisées, ni aux classes supérieures ; des groupes sociaux qui se situent entre les deux, assimilés à des classes intermédiaires. Pour autant, l’expression « classe moyenne rurale » devrait être utilisée au pluriel pour souligner la variété et l’hétérogénéité des situations et perceptions auxquelles elle peut renvoyer.
Pour délimiter les contours des CM rurales (CMR), les auteurs de cette étude ont opté pour une approche plurielle qui regroupe à la fois l’approche statistique situant les CM autour de la médiane des niveaux de vie, les approches semi-quantitatives définissant un seuil d’accès à une vie décente, et l’approche subjective qui se veut une auto-évaluation par les ménages eux-mêmes.
Toutes les approches montrent que les CMR ont connu d’abord une baisse entre les années 1984 et 2001 due notamment aux sécheresses récurrentes des années 1990, ensuite une hausse entre les années 2001 et 2007 en raison, entre autres, d’une croissance économique et sociale élevée ainsi que du désenclavement, puis une baisse entre les années 2007 et 2017, compte tenu de l’impact de la crise mondiale et des réformes payées par les CM.
Les CMR sont aussi bien économes qu’opportunistes vis-à-vis des programmes sociaux. Elles se caractérisent généralement par des familles élargies qui comptent sur l’éducation, un taux d’emploi élevé et une prédilection pour le secteur tertiaire. Leurs statuts socioprofessionnels restent fortement hétérogènes alors que seuls 37,8% des chefs de ménages sont exploitants agricoles.
Comme démontré par plusieurs spécialistes, les territoires ruraux ne peuvent être associés systématiquement et entièrement au secteur agricole. Contrairement à la dépendance totale à l’agriculture, la pluriactivité représente un atout considérable pour les CMR, favorisant l’élargissement de cette classe.
Alerte: La baisse de la pauvreté n’est pas synonyme d’un élargissement des CMR !
« Ce n’est pas parce que nous mettons en place des programmes de lutte contre la pauvreté que nous développons forcément une classe moyenne », affirme Larbi Zagdouni, agroéconomiste et coordinateur de l’étude pour le compte de l’IRES avec Mohamed Douidich, Abdelhak Kamal et Zakaria Kadiri, dans un séminaire organisé par les Laboratoires de recherche CRESC (Centre de Recherches et d’Études sur les Société Contemporaines) lié à l’association de recherche Action Targa-Aide, et LADSIS (Laboratoire de recherche sur les différenciations Sociales et les Identités Sociales) lié à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock – Université Hassan II de Casablanca.
Plusieurs catégories sociales existent entre les « pauvres » et les « riches », à savoir les classes vulnérables, les classes flottantes ou encore les classes moyennes. On y souligne à cet égard que la baisse de la pauvreté rurale a servi plus à la massification des classes flottantes qu’à un élargissement des classes moyennes.
En effet, corréler automatiquement la baisse de la pauvreté à l’émergence de la CMR donne lieu à une massification de classes qui ne rend pas compte du fait que la société marocaine est, avant toutes choses, composite et différemment stratifiée et engendre une polarisation sociale qui dissimule la complexité et la diversité des situations.
Un point sur les facteurs d’élargissement des CMR à l’échelle régionale
Bien que la consistance démographique des CMR entrave l’élaboration d’un traitement territorialisé des facteurs d’élargissement de ces classes, l’étude s’est penchée sur les zones rurales où les CMR sont les mieux développées, notamment les zones rurales des régions riches, et sur les régions où les CMR s’élargissent le mieux, à savoir celles où les inégalités sont en baisse.
Concrètement, seule la région de Rabat-Salé-Kénitra et les régions du sud favorisent l’élargissement des CMR, tandis que les régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Drâa-Tafilalet demeurent les plus adverses aux CMR.
Craintes et priorités des CMR, marqueurs d’une identité collective
Selon l’étude, les CM rurales craignent souvent une régression sociale qui se caractérise, entre autres, par la cherté de la vie, la baisse des revenus, le chômage des jeunes, la sécheresse, et l’inaccessibilité aux soins de santé. En même temps, ces groupes sociaux insistent sur des hautes priorités telles que la croissance économique et l’emploi, la lutte contre la délinquance et l’insécurité ainsi que la libération des énergies et l’investissement dans le capital humain des jeunes générations.
Quelles recommandations pour un développement durable des CM rurales ?
L’étude met en évidence le fait qu’aucune politique publique n’a cherché à cibler les CMR.
Les auteurs de l’étude prônent toutefois une nouvelle doctrine pour l’émergence des classes moyennes dans le monde rural, celle de l’articulation de trois orientations stratégiques, à savoir :
1) la lutte contre la pauvreté, couplée à la mobilité sociale ascendante ;
2) l’amélioration de la croissance et de la résilience de l’économie agricole et rurale à travers notamment l’accroissement de la productivité agricole, la couverture sociale au profit des agriculteurs, l’usage efficient et durable des ressources naturelles et la diversification de l’économie rurale ;
3) la réduction des inégalités via la mise en place des politiques d’inclusion et de protection sociale.
L’étude conclut sur les nouvelles politiques mises en place, dont les prémices confortent les conclusions et préconisations indiquées plus haut, à savoir le Programme Intelaka destiné à l’emploi des jeunes, particulièrement l’offre dédiée aux jeunes ruraux ; la stratégie « Génération Green 2020-2030 » ; la politique d’élargissement de la protection sociale ainsi que le récent rapport général du nouveau modèle de développement.
Médias24 annoncera la publication de l’étude lorsqu’elle sera diffusée.
L’auteur: Habiba El Mazouni, doctorante en sociologie politique à l’Université Hassan II de Casablanca
Le 24 juin 2021
Source web Par : medias24
Les tags en relation
Les articles en relation

Maroc : croissance du PIB 2024 et défis extérieurs
L’économie marocaine a progressé de 3,8 % en 2024, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), contre 3,7 % en 2023. Cette croissance est portée par la vital...

Zoom sur le secteur primaire dans le Sud du Royaume
Guelmim-Oued Noun, Laâyoune Sakia-Al Hamra, Dakhla Oued-Eddahab… Trois régions du Sud du Royaume qui misent sur le secteur primaire pour leur développement...
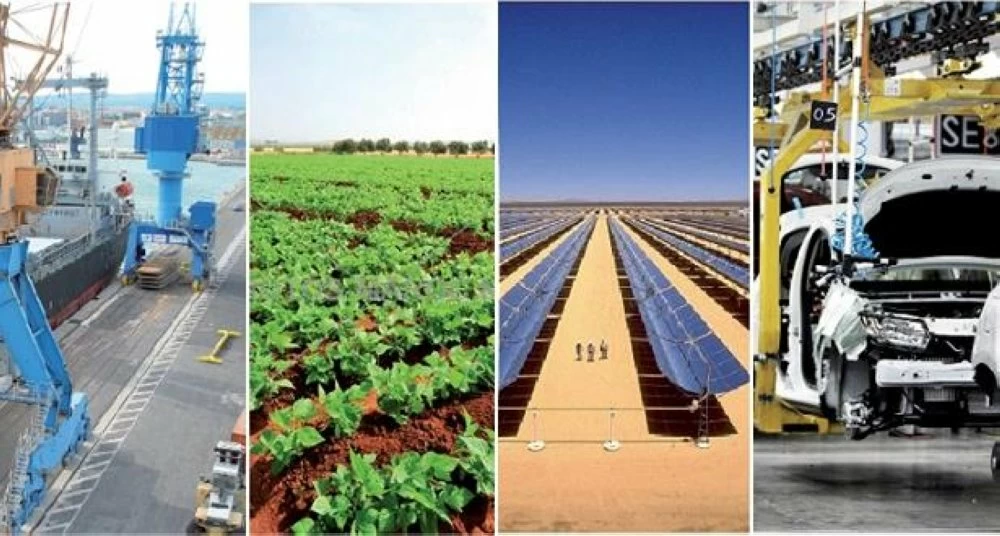
Investissements au Maroc : 1.300 milliards d’ici 2030, secteur privé moteur
Selon un rapport d'Attijari Global Research (AGR), réalisé en collaboration avec l'Africa Development Club, le Maroc devrait connaître un afflux mass...

Fruits contaminés : alerte sur les pesticides au Maroc
Chaque été, le Maroc est confronté à une recrudescence d’intoxications alimentaires dues à la consommation de fruits contaminés, notamment melons et pas...

La situation économique du Maroc vue par la Banque mondiale (nouveau rapport)
Présentation, mardi 29 juin, du rapport semestriel de suivi de la situation économique du Maroc, qui inclut un chapitre dédié à l’analyse des dynamiques ...

Programme d’approvisionnement en eau: Les détails
Le financement du programme national d’approvisionnement en eau potable, qui nécessitera un investissement de 115,4 milliards de DH, a été finalisé, a ind...

Maroc : Synergies entre Énergies Renouvelables et Gestion Durable de l’Eau pour un Avenir Écolog
Le Maroc, situé au carrefour de l’Europe et de l’Afrique, se positionne comme un acteur majeur de la transition énergétique en Afrique tout en affrontant...

Rapport 2023-2024 de la Cour des Comptes : Risques et gestion de l’eau
Dans son rapport annuel pour l'exercice 2023-2024, la Cour des Comptes a mis en évidence plusieurs risques pouvant freiner la mise en œuvre des grands pro...

Produits agricoles/Aid Al-Adha: offre suffisante, prix en baisse (ministère)
A l’approche de Aid Al Adha, le marché des produits agricoles et alimentaires reste bien approvisionné et les prix des principaux légumes et fruits affiche...

Le spécialiste des systèmes d’irrigation s’installe à Dakhla
Après Agadir et Meknès, Magriser, acteur de référence dans la production, la distribution et l’installation des systèmes d’irrigation ouvre ce lundi 7 ...
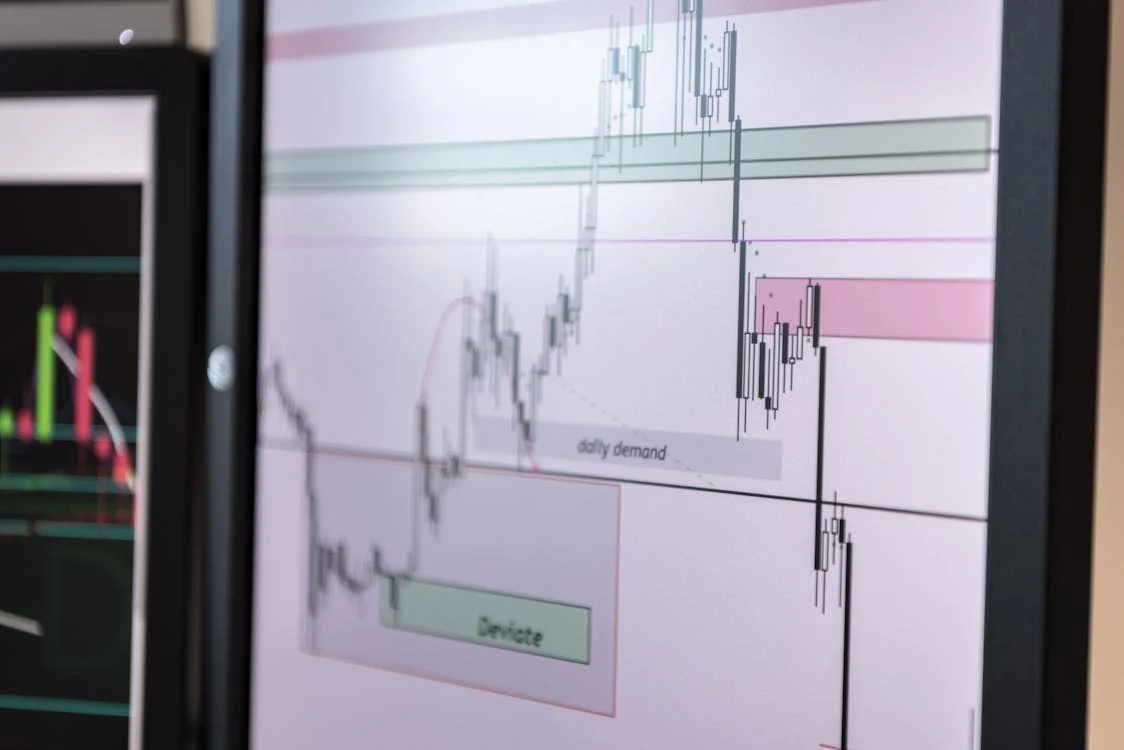
Perspectives Économiques du Maroc : Une Croissance de 5 % Attendue en 2025 Selon Fitch Solutions
La croissance économique du Maroc devrait atteindre 5 % en 2025, après une estimation de 2,6 % en 2024, selon une analyse récente du cabinet BMI, filiale de ...

Stress hydrique au Maroc : Menace pour économie et alimentation
Le Maroc fait face à un défi majeur lié à la sécheresse et à la raréfaction des ressources en eau, selon un rapport alarmant de la Banque mondiale repris...


 lundi 28 juin 2021
lundi 28 juin 2021 0
0 










































 Découvrir notre région
Découvrir notre région