L'architecture des mosquées rurales dans la région de Tata

Introduction
L’architecture religieuse est un aspect majeur du patrimoine architectural de la province de Tata.Que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif, elle est d’une richesse étonnante. Les travaux menés dans la zone entre 2003 et 2007 par une équipe d’archéologues de la Direction du patrimoine culturel, ont permis le recensement et l’étude d’un nombre considérable d’édifices historiques de ce genre présentant des caractéristiques architecturales et décoratives qui permettent de dégager un style particulier à cette région. En effet, dans cette zone, l’enquête de terrain nous a livré 101 oratoires ayant une valeur sur le plan historique et dévoilant des traits architecturaux originaux.
A l’instar de tous les édifices de culte musulman, les mosquées de la province de Tata sont composées de tous les éléments habituels : on retrouve d’abord, la salle des prières qui représente le noyau de l’édifice où sont accomplis les rituels de la prière,puis la salle des ablutions dotée de latrines. Le minaret étant un élément rare, on trouve enfin un certain nombre de structures annexes telles Akherbich qui est une salle disposant d’un foyer où est chauffée l’eau pour les fidèles, un puits ou une etfiya (citerne de stockage des eaux), une chambre réservée à l’hébergement de l’imam qui est dans la plus part des cas, étranger au village et dans certains cas, on note l’existence du msid (école coranique) qui jouxte souvent la mosquée et où le fqih est chargé de la mission d’enseignement des imehdarene. Dans cet article il serait question de présenter les résultats préliminaires de cette opération d’inventaire et des éléments de synthèses sur l’architecture religieuse de Tata traitée selon une approche comparative. Il ne s’agit pas d’aborder des questions d’ordre chronologiques, mais plus des problématiques relatives à l’ordonnancement et à la typologie de ces mosquées. L’analyse concernera les différentes composantes spatiales, architecturales et décoratives de ces édifices selon la classification adoptée généralement par les études architecturales et archéologiques. Mais avant d’approcher ces questions dans le détail, il importe de situer ce patrimoine religieux dans le cadre physique et dans le contexte historique où il a vu le jour et où il s’est développé.
Aspects physiques et repères historiques de Tata :
La province de Tata fait partie des régions subsahariennes du Maroc. Son territoire s’étend du versant sud de l’anti-Atlas jusqu’à la vallée du Drâa. Le relief de la province est composé en général des massifs de l’Anti-Atlas, de l’Ouarkziz et du Bani, de la Hamada de Drâa ainsi que des vastes plaines caillouteuses connues sous le nom de Regs. La région présente une homogénéité physique avec un paysage oasien dans les endroits où le potentiel hydrique est facilement exploitable et un autre désertique dans les zones sahariennes et rocailleuses. Vu cette position géographique, Tata bénéficie d’un climat continental saharien où la température varie entre 50° durant l’été et moins de 0° en hiver. La moyenne des précipitations enregistrées ne dépasse guère les 100 mm par an. Et mis à part les quelques chutes hivernales sporadiques, les ressources hydriques de la région sont essentiellement dues aux eaux d’infiltrations provenant des pluies des montagnes de l’Anti-Atlas et qui sont déversées dans l’oued Drâa. Ces eaux rechargent les nappes phréatiques, alimentent les sources et les Khettaras et profitent positivement à l’irrigation des oasis.
Sur les plans historique et archéologique, les prospections menées dans la région ont permis la découverte de plusieurs indices archéologiques remontant au paléolithique dont notamment des sites de plein air, riches en outillage lithique. Par ailleurs, la province a connu depuis ces périodes lointaines un peuplement intense matérialisé par les dalles gravées qui composent les quelques 120 sites rupestres découverts à nos jours, dans les différentes zones de la province. Les centaines de tumuli préislamiques parsemant tout le territoire, apportent un indice supplémentaire sur une présence humaine forte et ininterrompue de l’homme dans ces contrés.
Les sites archéologiques et les monuments d’époques historiques se comptent par centaines : greniers collectifs (igoudar), tours de guet, maisons, villages fortifiés, mosquées, zaouïas et koubbas se rencontrent pratiquement dans toutes les oasis, le long des itinéraires et même dans les coins les plus isolés, témoignant ainsi de la densité du peuplement qu’a connu la région depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours. En effet, la région occupait une position stratégique et bénéficiait d’un rôle très important dans le réseau du commerce caravanier qui reliait le Maroc aux pays de l’Afrique subsaharienne et la cité minière de Tamdoult, le village historique de Jbaïr, la forteresse de Tagadirt Ouguellid et le village ruiné de Tghit ainsi que plusieurs autres sites sont là pour témoigner de ce rôle prépondérant qu’a joué la région le long de l’histoire médiévale.
I. La salle des prières et ses composantes
1. La salle des prières
La salle des prières connue en tamazighte sous le nom de lmeqsourt, représente le noyau de base de la mosquée, C’est au sein d’elle que sont exercés les rituels de la prière qui est l’un des piliers de l’Islam. Les salles de ces mosquées rurales sont généralement de petites dimensions. Ceci s’explique par le nombre limité des populations masculines de ces communautés villageoises.
Pour mieux apprécier les dimensions de ces édifices religieux, nous nous attelons dans ce qui suit à présenter quelques mesures les concernant.
Ainsi, le plus vaste oratoire de la province qui se trouve dans le village historique d’Aguerd dans la commune de Tamanarte, fait 16.80 mètres de profondeur sur 23 mètres de largeur et le plus petit parmi les édifices recensés est celui de Talilt dans la kasbah d’Alougoum qui ne fait que 6.45 de profondeur sur 8.60m de large ainsi que celui de Fiferd dans la commune d’Aguinane qui dispose d’un plan presque carré mesurant 8 m de côté.
Ces oratoires adoptent des plans divers oscillant entre le rectangle et le carré, mais ils présentant le plus souvent des déformations au niveau de certains côtés en raison de la topographie accidentée du site. Ces anomalies de plan rares au niveau des murs nord et sud ne sont fréquentes qu’au niveau des façades est et ouest, ce qui ne porte pas atteinte à l’ordonnancement des nefs parallèles au mur de la qibla.
Mosquée d'Ighir à Tamanart
Au niveau de la disposition interne, ces mosquées rurales présentent de grandes
similitudes entre elles. En effet, elles sont subdivisées en plusieurs nefs parallèles au mur de la qibla dont le nombre varie en fonction de la grandeur de l’édifice et dont l’agencement rappelle les premières mosquées marocaines d’époque idrisside et tardivement certaines mosquées alaouites.
Cette tradition ancienne s’est développée et s’est maintenue surtout à Fès. Mais
l’arrivée des Almohades a crée une rupture avec ce mode d’organisation des salles des prières en Occident musulman pour voir naître les célèbres mosquées à nefs perpendiculaires au mur de la qibla où la nef axiale occupe une place de choix et forme avec la travée de la qibla le fameux dispositif en T qu’on retrouve bien illustré à la Koutoubiya de Marrakech et par la suite dans la quasi-totalité des mosquées mérinides, saadiennes et alaouites.Le nombre des nefs composant les salles de culte, varie en fonction de l’importance des édifices. Il est de deux pour les oratoires les plus humbles tels que ceux de Jbaïr et d’Aygou et de six à sept nefs pour les plus vastes qui se trouvent respectivement à Amtzguine (commune de Tlit) et à Aguerd (commune de Tamanarte).
Les nefs sont délimitées par des rangées d’arcades composées d’une succession
d’arcs plein cintre ou brisés reposant sur des piliers carrés, rectangulaires, circulaires ou octogonaux, dont la hauteur varie d’une mosquée à l’autre, mais les toitures se situent d’une manière générale à une hauteur de quatre et six mètres.
Le mur de la qibla est percé de plusieurs niches dont notamment celle du mihrab et
du minbar. L’accès à la salle des prières se fait soit directement par une porte desservie par un couloir menant vers la porte principale du complexe religieux ou par une petite porte de communication souvent latérale et mitoyenne avec la salle d’ablutions.
Mosquée d'Oum Hnech (Foum Zguid)
La lecture des dispositions des nefs en rapport avec les matériaux et les techniques de construction mis en oeuvre, nous permet de déceler deux phases évolutives dans le processus d’élaboration des plans de ces mosquées :
• La phase initiale se caractérise par un ordonnancement primitif de la salle qui se présente sous forme de deux à trois chambres plus larges que profondes ne communiquant entre elles que par des ouvertures simples à linteaux donnant la forme d’un arc à encorbellements reposant sur des piliers rectangulaires massifs et couvertes de charpentes traditionnelles dans le style local.
Dans cette catégorie un cas typique mérite d’être souligné c’est la mosquée d’Aygou, dans la commune Tigezmirt, qui s’inscrit dans le même plan sauf que les deux nefs sont séparées par un mur percé de deux petites ouvertures ce qui donne plus l’allure d’un espace sombre et fermé. Cet oratoire présente la particularité d’être couvert par des voutes en berceaux réalisées en maçonnerie de pierre.
• La seconde phase est marquée par l’apparition de l’arc sous différentes formes
mais surtout de l’arc plein cintre présentant parfois une brisure et souvent une
imperfection dans l’exécution ainsi que des rangées d’arcades pour soulever la charpente et donner à la salle des prières ce caractère d’ouverture indispensable pour un lieu de culte et de communion.
Dans cette disposition un cas particulier fait l’exception à la tradition et mérite d’être souligné. Il s’agit de la mosquée Tichekji à Issafene où le plan à nefs parallèles au mur de la qibla est respecté mais avec l’introduction d’un certain nombre d’innovations qui en font un plan original. Ainsi l’ordonnancement des arcades nous permettent de déceler un plan cruciforme ce qui est à notre connaissance, un plan unique de son genre dans l’architecture religieuse de l’Islam en général et celle du Maroc en particulier. Malgré leur modestie, les salles des prières sont d’une beauté sobre et discrète contenue dans la silhouette des arcades et la forêt de piliers multiformes qui se dressent au milieu et surtout dans les belles charpentes de bois qui les couronnent.
2. Les courettes et les puits de lumière et d’aération
Que ce soit au Maroc ou ailleurs, la cour à ciel ouvert ou le sahn occupe une place prépondérante dans l’architecture des mosquées. A Tata et en raison du climat désertique sévère de la région marqué essentiellement par la chaleur torride de l’été qui est le plus souvent accompagnée de tempêtes de vents et par un froid glacial l’hiver, ces oratoires sont presque fermés sur l’extérieur. On y accède le plus souvent par des allées couvertes qui permettent de réduire les effets néfastes de ces aléas climatiques.
De ce fait, les cours spacieuses, organes indispensables pour l’éclairage, l’aération d’une mosquée et pour l’achèvement ou le renouvellement des ablutions rituelles pour les fidèles sont quasi inexistantes. Elles sont substituées par des courettes qui jouent plus le rôle de puits de lumière et d’aération. Ces espaces réduits qui ont des formes carrées ou rectangulaires, ne dépassent par dans les meilleurs cas quatre mètres de côté. L’exemple le plus significatif se trouve dans la mosquée d’Aït Kine à Tagmout qui représente l’unique exemple de sahn au sein de la salle des prières avec celui de la mosquée d’Aguerd qui est sous forme d’un espace découvert à l’entrée de la salle et qui permet la communication entre les différentes composantes de la mosquée. Ils se présentent sous forme de cours à ciel ouvert de forme presque carrée.
A part ces deux cas, le reste des bâtiments présente un à deux puits de lumière et d’aération d’environ 2 m de côté et couverts de petites charpentes supportées par des piliers d’angles et se situant à un niveau plus haut par rapport aux toitures de la mosquée pour permettre l’infiltration de l’air et de la lumière à travers des fenêtres rectangulaires. Les façades de ces espaces d’éclairage et d’aération sont parfois ornées de frises décoratives en relief réalisées en stuc ou en plâtre et de corniches exécutées en dalles de pierre plates et en longrines de bois disposées sous forme de rangées de consoles. Le décor géométrique simple est amplifié par celui des charpentes traditionnelles savamment réalisées en bois peint dans le style local.
3. Le muret en face du mihrab
Cette structure qui se dresse curieusement au fonds de la salle des prières et qui se présente sous forme d’un muret reliant les deux piliers à côté du Mihrab et barrant par conséquent, l’ouverture de la travée axiale menant vers cette niche, se trouve dans la quasi-totalité des édifices recensés. Il s’agit d’un mur dont l’épaisseur est plus ou moins égale à celle des piliers sur lesquels il s’appuie, avec une hauteur ne dépassant pas les 70 cm. Il est construit dans les mêmes matériaux que les éléments porteurs de la mosquée qui sont soit la brique de terre crue ou la maçonnerie de pierre jointe par un mortier de terre.
Cette structure spécifique à cette région et inhabituelle dans les mosquées marocaines en générale, a pour fonction la délimitation de l’espace bordant le mihrab qui représente le coeur de la mosquée et ce en vue de créer un espace de communion, où un nombre restreint de fidèles se réunissent pour la lecture du coran exploitant ainsi le muret pour s’y adosser. Une autre fonction qui est venue s’ajouter par la suite à la première est que cette banquette est devenue une étagère de rangement des Corans et d’autres outils liturgiques tels les chapelets et les galets qui servent aux ablutions spécifiques connues sous le nom de tayamoum.
4. Le Mihrab
Le mihrab est la niche destinée à indiquer aux fidèles la direction de la qibla. Les niches de mihrabs des mosquées inventoriées sont généralement, d’une composition simple affectant le plan des mihrabs à pans coupés. Elles varient entre la forme semicirculaire, pentagonale et hexagonale. La niche est souvent couverte d’une coupolette simple ou côtelée.
Les entrées des mihrabs sont généralement alignées avec le mur de la façade de la qibla sauf dans de rares cas où il est en en saillie par rapport à ce mur. Les façades des mihrabs étudiés permettent de dégager un style de composition qui a été suivi par presque tous les maîtres artisans et qui a constitué une tradition dans l’architecture des mosquées de la région. Ce sont généralement des façades simples dont les traits principaux sont l’ouverture de la niche qui se fait en arc plein cintre ou brisé parfois circonscrit d’une voussure en arc polylobé, festonné ou à lambrequin. Cet arc de petite dimension s’inscrit dans un cadre rectangulaire enduit de chaux ou de plâtre, dont les écoinçons sont lisses. Le tout est englobé dans un ou plusieurs grands cadres rectangulaires bordés de moulurations et coiffés d’une série de petites niches aveugles ou ajourées, défoncés dans le mur et dont le nombre est le plus souvent trois. Une sorte de corniche faite de bandes moulurées, couvre le tout et se rapproche parfois de la forme d’un petit auvent coiffé d’une rangée de tuiles.
Certaines façades de mihrab, bien qu’elles s’inscrivent par leurs traits principaux dans le même style de composition, rompent complètement avec la simplicité qui caractérise la majorité de ces niches. C’est ainsi que nous assistons dans certains mihrabs tels que ceux de Fiferd (Aguinane) Imi n Tatelt (Ben Yaakoub) et Tiskmodine (Akka Ighane) à une profusion d’un décor polychrome à dominance géométrique et florale. Ce décor couvrant et peint sur enduit, présente dans certains cas des inscriptions commémorant la date de construction ou de rénovation. Parfois c’est un décor en stuc sculpté fait d’une combinaison d’éléments géométriques et floraux.
5. La salle de prière des femmes
A Tata ces salles annexes n’existaient pas à l’origine, ce qui prouve que les femmes, par tradition, ne se rendaient pas à la mosquée pour les prières communes. Pour leur permettre d’accomplir cet acte, elles sont maintenant admises à assister à la prière, séparément des hommes dans des endroits spéciaux qui leur sont réservés, et ce conformément aux principes de la loi musulmane.
Les salles actuelles situées dans la partie arrière des mosquées ne sont que des aménagements récents. Les gens procèdent généralement à murer la dernière arcade pour isoler une partie de la nef arrière qui est affectée en salle des prières pour les femmes. Dans d’autres cas, comme à Anghrife (commune Oum Elguerdane) et à Aït Harbil (commune Tamanarte) notamment, on a consacré des mosquées entières pour les femmes parce qu’elles sont devenues trop étroites pour accueillir un nombre croissant d’hommes.
6. Le mihrab et la salle de prière d’été
La anza est un panneau en bois destiné, à l’instar du mihrab, à indiquer l’orientation de la qibla pour les fidèles qui font leurs prières dans le sahn, surtout pendant la saison estivale. D’habitude ce mobilier, placé face à la cour de la mosquée, à l’entrée de la salle de prière, s’accompagne d’une entaille qui est aménagé sur le seuil reliant le sahn à la nef axiale et épouse la même forme que la niche du mihrab.
A Tata, ce dispositif n’existe pas et c’est la terrasse de la mosquée qui joue ce rôle surtout l’été pendant les deux dernières prières du soir. Peu d’aménagements sont généralement prévus pour donner à la terrasse cette fonction : d’abord un mur de clôture pour une question de sécurité des fidèles et un mihrab qui n’est en réalité qu’un rehaussement de celui du niveau bas.
II. La salle d’ablutions et ses annexes
1. La salle d’ablutions et les latrines
Du fait que le rituel de purification est un acte obligatoire pour la validité des prières quotidiennes, la salle d’ablutions et les latrines sont des annexes quasi indispensables dans l’architecture des mosquées. A Tata, elles sont désignées par deux vocables : mida et dar al wdou et on les retrouve dans la totalité des mosquées recensées. La salle d’ablutions et les latrines sont des locaux d’une importance majeure, ceci est prouvé par l’intérêt architectural qui leur est accordé et par la place et la superficie qu’elles occupent au sein de la mosquée. En effet, elles se présentent comme des bâtiments indépendants, isolés des salles des prières et prennent des dispositions variées :
• Dans la première catégorie qui est la plus dominante, le plan de cette salle est très simple. Il se réduit à une grande chambre rectangulaire dotée sur un ou deux de ses côtés, de latrines, tandis que le reste de l’espace est pourvu de banquettes sur lesquelles les gens s’installent pour achever leurs rituels.
• Dans la seconde, cette salle est de plan plus ou moins carré et comporte une courette de même forme, occupée au centre par un bassin ou un puits et entourée de banquettes et par un ensemble de latrines de petites dimensions. Isolés du lieu de culte, ces locaux prennent différentes positions par rapport aux salles des prières, ils se situent soit en arrière de ces salles soit dans ses deux côtés latéraux. Les exemples les plus significatifs se trouvent dans les mosquées d’Aguerd et d’Ighir à Tamanarte
• La troisième catégorie est de plan plus élaboré. Elle représente une phase plus évoluée du plan de la deuxième catégorie et rappelle par sa disposition ainsi que par ses techniques de construction et de couverture les midas des grandes mosquées urbaines. Il s’agit d’un pavillon carré central couvert d’une coupole et qui s’ouvre des quatre cotés par des arcs. Ces ouvertures donnent sur une galerie qui se développe tout autour de ce noyau. Elle est couverte de voûtes en berceaux qui se joignent dans les coins par des voûtes d’arrête ou de simples charpentes en bois. Sur une ou deux des façades internes sont percées des petites portes qui donnent accès aux latrines. Parmi les exemples représentatifs de cette catégorie on note la mosquée d’Adekhs à Aguinane et celle d’Agadir n Tissint.
• La quatrième disposition est la plus remarquable sur le plan architectural et la plus étonnante par la position qu’occupent les locaux d’ablutions au sein de la mosquée. Dans cet ordre, la salle est de plan rectangulaire avec des dimensions très importantes atteignant parfois et dépassant même ceux de l’oratoire comme est le cas à Imi Ougadir (commune de Fam Lhissne). La salle est traversée en longueur par des arcs élevés qui servent d’arcs de décharge supportant les toitures. L’une de ses façades internes est occupée par une série de latrines tandis que dans l’autre côté est aménagé le puits qui alimente la mosquée en eau. Au milieu coure une rigole de collecte et d’évacuation des eaux usées. Les cas représentatifs de ce mode d’ordonnancement ne sont pas nombreux. Quatre exemples ont été identifiés à Fam Lhissn, à Tlit et à Alougoum. Deux d’entre eux prennent une position normale au nord de la mosquée, alors que les deux autres occupent curieusement la façade externe sud et se trouvent par cette situation accolées au mur de la qibla et incorporant au sein d’elles la niche du mihrab et celle du minbar.
2. Autres structures annexes
2.1. Akherbich :
C’est un local contigu à la salle d’ablutions où l’eau est chauffée pour les besoins de purification du corps avant d’entamer la prière. Le bâtiment affecte la forme d’un carré ou d’un rectangle au centre duquel est aménagé le foyer à un niveau plus bas par rapport au sol et qui prend une forme carrée ou circulaire. Juste au dessus est suspendue tafedna ou anas, grand récipient en cuivre attaché aux poutres de la charpente et doté d’une grande louche dont se servent les fidèles désireux de se purifier, pour puiser l’eau chaude. Dans l’un des coins de cette pièce sont stockés des tas de bois. De nos jours la plupart de ces locaux ne sont plus fonctionnels et le système de chauffage traditionnel est presque partout remplacé par un autre plus moderne à gaz.
2.2. Le puits
Pour assurer l’alimentation de la mosquée en eau suffisante, les membres de la communauté procèdent le plus souvent au creusement d’un puits aux alentours de la mosquée et de préférence tout près des lieux consacrés aux ablutions. Le puisage de l’eau se fait de la façon la plus simple par le biais d’un seau tiré à la main ou à l’aide d’une poulie.
2.3. La citerne (metfiya)
A défaut d’une source d’approvisionnement en eau, les gens ont recours à l’aménagement de grandes citernes où sont stockées de grandes quantités d’eaux. Ces dernières proviennent soit des pluies collectées au niveau des terrasses et conduites à l’aide de canalisations, soit au moyen de seguias qui acheminent l’eau depuis les sources. Ces structures hydrauliques creusées profondément dans le sol, sont de forme rectangulaire et sont parfois pourvues de petits bassins de décantation. Elles sont couvertes soit de dalles traditionnelles ou de voutes en berceau maçonnées en pierre.
2.4. Le bassin
C’est une structure hydraulique découverte sise à l’intérieur de la salle des ablutions mais qui n’existe pas dans toutes les mosquées. Elle est remplie d’eau froide dont peuvent se servir les fidèles pour les besoins de purification du corps. Elle est alimentée soit à partir du puit et de la citerne qui se trouvent juste à côté ou directement par le biais d’un seguia quant la mosquée se situe à un niveau plus bas du douar. Ce bassin généralement de dimensions réduites, est de forme rectangulaire ou carrée. Il est aménagé à un niveau plus bas du sol. Sa maçonnerie est couverte d’une couche imperméable réalisée en mortier de chaux.
III. Les masses architecturales
1. Les minarets
Le minaret localement connu sous le nom de tassoumaat, est une masse architecturale destinée à l’appel des fidèles pour les cinq prières du jour. Dans les oratoires historiques de Tata, les minarets sont rares. Les quelques spécimens inventoriés lors des travaux de terrain ne dépassent pas quatre : on trouve la fameuse tour tronquée de la Kasba de sidi Abdellah ben Mbarek, celle de Rehala et sa voisine de douar Zaouia qui se trouvent toutes non loin d’Akka et enfin celle d’Aguerd à Tamanarte.
Cette rareté peut s’expliquer par le non besoin d’avoir recours à ces tours pour l’appel à la prière en raison de l’exiguïté de l’espace des villages et de la faible hauteur des bâtiments environnants, ce qui permet au muezzin de faire appel à la prière sans risque de ne pas être entendu par les habitants des différents coins de la localité.
Les quatre minarets recensés sont de style maroco-andalous et s’inscrivent par conséquent dans la tradition des minarets marocains. De plans carrés ils se composent de la tour proprement dit qui est surmontée d’un lanternon. L’accès au sommet du minaret se fait par le biais d’un escalier qui se développe autour d’un pilier central massif réalisé en solide maçonnerie de pierre.
Les deux minarets d’Akka sont construits en en brique de terre cuite jointes par un mortier riche en chaux, celui de Douar Zaouïa en brique de terre crue alors que celui d’Aguerd est exclusivement réalisé en maçonnerie de pierre.
2. Les façades et les portes d’entrées
En l’absence des minarets, les mosquées se distinguent et se reconnaissent au sein des douars par leurs façades principales et leurs portes d’entrées qui sont généralement d’une allure monumentale et conçues dans de grandes proportions et de très belles compositions architecturales et décoratives.
Au niveau des portes on note une grande variété de styles bien qu’elles s’inspirent toutes du modèle de la porte urbaine marocaine. Il s’agit en général de structures monumentales érigées sur des hauteurs dépassant parfois les six mètres. L’accès se fait généralement par des ouvertures en arcs plein cintre ou des ouvertures à linteaux, circonscrits de voussures de mêmes formes ou polylobés et à lambrequins.
Ils sont tous inscrits dans des cadres rectangulaires et surmontés de frises composées de niches aveugles, d’arcatures de types variés et d’éléments architectoniques en relief à caractère décoratif, soit taillés dans la pierre ou exécutés en stuc ou en mortier de chaux.
Le tout est coiffé de corniches à bandeaux moulurées ou de cadres remplis de motifs géométriques recticurvilgnes communément connus sous le nom de ktef w derj que couvrent en fin de compte des charpentes ou des auvents de formes diverses (consoles de bois avec arases de pierre ou maçonnerie en saillie, rangées de tuiles vertes…)
Pour ce qui est des façades principales, la plupart d’entre elles sont réalisées dans une belle maçonnerie de pierre parfois taillée. Certaines sont de proportions remarquables comme celle de Tighremt à Alougoum qui présente au milieu des rangées d’arcatures que coiffe une corniche de pierre supportée par des consoles taillées dans le même matériau.
3. Les coupoles et les voûtes
Beaucoup plus utilisés dans l’architecture funéraire (koubba et zaouïa) et les ouvrages hydrauliques (citernes et metfiyas), les coupoles et les voûtes sont des masses architecturales d’usage rare dans l’architecture des mosquées de la région. Cinq édifices seulement parmi ceux recensées disposent de ce type de couvertures qu’on ne trouve que dans les salles d’ablutions, sauf dans l’unique cas précédemment signalé de la mosquée d’Aygou (commune Tigzmirt) où les nefs sont couvertes de voûtes en berceaux et aussi dans l’exceptionnelle mosquée de Tichekji dont le centre de la salle des prières est couvert d’une coupolette atypique.
Les coupoles ont des formes variées allant de l’octogonale à l’ovoïde en passant par la forme circulaire. Elles reposent toutes sur des bases carrées ou rectangulaires et le passage vers la forme de coupole se fait à partir de la base par le biais de trompes en niches ou par le moyen de traverses en bois qui coupent les quatre angles pour permettre cette transition.
Ces masses architecturales sont toutes construites en maçonnerie de pierres jointes par un mortier richement dosé en chaux et protégée par une couche d’enduit à base de ce liant. La forme de voûtes la plus dominante est celle en berceaux qui couvre les galeries entourant les coupoles des salles d’ablutions et exceptionnellement les nefs de la mosquée d’Aygou. Ces couvertures sont bâties en maçonnerie de pierre liée par un mortier de chaux et enduites aussi d’un crépi à base de chaux.
4. Les charpentes traditionnelles
Si les charpentes jouent un rôle primordial en tant que structures porteuses des toits des mosquées, elles contribuent fortement en outre, à l’ornementation de ces espaces où règne la simplicité conformément aux principes rigoureux de la religion musulmane. Bien qu’elles s’inscrivent dans un style connu localement sous le nom de Tataoui, ces ossatures en bois présentent une grande variété que ce soit au niveau des formes, des dispositions des éléments en bois ou sur le plan de la décoration qui leur est appliquée.
La charpente traditionnelle de style local est généralement faite dans plusieurs essences de bois mais le palmier reste très dominant. Elle se compose des éléments suivants :
• Les poutres (lqendert) qui sont de grandes longrines en bois qui supportent de grandes charges. Ici ce sont les troncs de palmiers entiers aiguisés qui jouent ce rôle. • Les solives (tasatourt) qui sont des sortes de chevrons qui comblent le vide entre les poutres. Elles sont obtenues à travers le découpage longitudinal des troncs en plusieurs éléments.
• Le voligeage est généralement fait de petits rondins de laurier rose, de fragments de bois de palmiers ou de roseaux. Concernant les formes attribuées par les maîtres artisans à ces couvertures, elles sont variables.
Cependant la forme rectangulaire de charpente allongée qui épouse le plan des nefs est la plus caractéristique. Celle de la mosquée de Tichekji déroge à la règle et l’on trouve des charpentes carrées et d’autre en forme de U longeant le mur de clôture et circonscrivant la moitié de l’oratoire.
Concernant leurs techniques d’exécution, on note deux procédés majeurs au sein desquels se trouvent plusieurs variantes
• Le premier qui est le plus dominant se caractérise par des solives entre lesquels s’enchevêtrent d’une belle manière des voliges en bois de laurier, des bûches taillées de palmier sous plusieurs formes ou des tiges de roseaux. Le tout est peint de couleurs où dominent l’ocre, le noir, le jaune et le blanc, ce qui offre une décoration sous forme de tapis géométriques polychromes.
• Le second style qui est rare et qu’on ne trouve que dans quelques oratoires, notamment à Timzguida afella sise à douar Assa (Tagmout) et surtout dans la mosquée Tichekji (Issafene). Dans ce modèle le voligeage est sous forme de planches de bois que portent des solives de bois massifs et équarries en vue de leur donner des formes géométriques carrées ou rectangulaires. Les deux éléments sont couverts de motifs géométriques, floraux et parfois épigraphiques gravés ou peints. Pour assurer leur imperméabilité surtout pendant les saisons pluviales, ces plafonds de bois sont couverts de couches de tout-venant et de terre argileuse.
Ces dernières sont arrosées et damées puis recouvertes d’une autre chape de terre présentant une grande quantité de minerais qui une fois sèche et solidifiée, offre une toiture étanche.
IV. Le mobilier des oratoires
1. Le mobilier liturgique
Il se compose essentiellement des minbars qui représentent le mobilier indispensable pour les mosquées où a lieu la prière du vendredi. Cette dernière se tenait jadis, dans la quasi-totalité des mosquées recensées. Le minbar est une chaire élevée et mobile à partir de laquelle l’imam s’adresse aux fidèles et prononce le prêche du vendredi.
Elle est habituellement rangé dans un réduit aménagé dans le mur de la qibla, et n’apparaît dans la salle de prière que ce jour. Peu de minbars ont échappé au trafic illicite des objets d’art très actif dans la région. Le nombre de ce genre de mobilier très prisé par les collectionneurs et les trafiquants n’est aujourd’hui que de cinq, tous réalisés dans un style simple et présentant une décoration qui s’inspire du registre artistique local qu’on découvre dans les portes en bois.
En effet, on note sur les deux faces latérales et sur le sommet de l’ouvrage la profusion d’un décor géométrique et floral polychrome et peint dont le tracé directeur est visible sur bois. En outre certains d’entre eux portent des inscriptions réalisées dans un style cursif (naskhi maghribi) commémorant généralement le premier jour de sa mise en service dans la mosquée.
Conformément à la tradition marocaine, les minbars des oratoires de Tata sont tous transportables et faits en bois massif.
2. Les portes en bois
Outre leurs fonctions évidentes d’éléments de clôture et de fermeture de ces espaces sacrées qui sont les mosquées, les portes en bois ouvragé et peint concourent aussi à leur embellissement par une combinaison de décor géométrique et floral dessiné, peint ou gravé. Ces motifs décoratifs s’inspirent du répertoire artistique dans lequel puisent les artisans du sud marocain qui s’étend depuis le Haut Atlas jusqu’aux piémonts sud-est de l’Anti-Atlas.
Malheureusement ces ventaux en bois richement décorés constituent des pièces d’art très convoitées par les collectionneurs, ce qui fait que peu d’oratoires conservent encore leurs portes d’origine.
V. Les matériaux et les techniques de construction et de décoration
Dans cette région semi désertique du sud-est marocain qui procure aux maîtres maçons, artisans et décorateurs un large choix au niveau des matériaux nécessaires et adaptés à la construction locale, l’usage est si hétérogène qu’on ne peut rattacher ces architectures seulement à la terre ou à la pierre et à tel point que d’un douar à l’autre le matériau de base et les techniques de construction mises en oeuvre changent ou coexistent au sein d’un même édifice.
Ce constat est valable pour l’architecture des mosquées historiques étudiées où l’on remarque dans le système constructif l’usage des matériaux et des techniques suivants:
• Le pisé ou la tabiya qui obéit aux mêmes principes de cette tradition architecturale et de ce savoir-faire très enracinés dans le sud marocain. C’est un mélange de terre creusée sur les lieux du chantier, arrosée puis damée dans un coffrage de bois ayant les dimensions d’un pan de mur. Les banchés se succèdent ensuite et s’alternent jusqu’à l’érection de la structure de la bâtisse.
La tabiya est surtout utilisée dans les murs de clôture de certains édifices. Pour éviter les effets néfastes des eaux de ruissellements et ceux des remontées capillaires, les constructeurs de murs en pisé recourent fréquemment, à la mise en place de soubassements solides en maçonnerie de pierre.
• La pierre est utilisée sous plusieurs formes et calibres bien que le moellon brut ou dégrossi est le plus courant chez les constructeurs des murs et des arcs qui en font de la maçonnerie jointe avec un mortier de terre ou de chaux et ou les lits sont disposés horizontalement.
Parfois la pierre est noyée dans le béton de chaux surtout quand il s’agit d’ériger des voûtes ou des coupoles. On trouve également la pierre calcaire ou schisteuse plate utilisée sous forme d’arases ou de dalles soigneusement superposées avec ou sans mortier pour constituer des parements de murs ou des corniches coiffant les édifices et les masses architecturales. La pierre de taille n’intervient que rarement dans les façades ou dans les chaînages d’angles des édifices.
• La brique de terre crue : Ce matériau réalisé localement avec de la terre arrosée et malaxée à la paille puis damée dans des gabarits fabriqués en bois à cet effet. La brique est séchée avant d’être utilisée dans la maçonnerie où elle est liée avec un mortier de terre. Ce matériau est surtout utilisé dans l’érection des arcs et des piliers ainsi que des murs de cloison.
• La brique de terre cuite : Elle est d’un usage très limité. Les deux seuls édifices témoins de son utilisation sont le minaret de la Kasba de Sidi Abdellah ben Mbarek et celui de Rehala dans la région d’Akka. C’est un matériau très solide et bien cuit qui une fois incorporé à un liant de chaux, offre une masse architecturale homogène et très solide.
• Le bois est un matériau d’une très grande valeur architecturale. Il est utilisé dans la construction des mosquées. Outre son large usage dans la fabrication des charpentes traditionnelles, il est utilisé comme élément de support. Ainsi il sert de linteau au dessus des ouvertures et de poutre porteuse de charges à la place des piliers. Il est aussi employé sous forme de sommiers supportant les départs des arcs et amortissant la charge provoquée par le poids des arcades et des dalles.
On fabrique également avec ce matériau des consoles et des auvents qui abritent les portes principales. Le bois est utilisé par les constructeurs des mosquées dans une technique ingénieuse de stabilisation de la structure et des arcades de la bâtisse par l’ancrage d’une série de longrines entre les rangées d’arcades.
Le décor des mosquées, malgré la simplicité des matériaux mis en oeuvre, puise ses sources d’inspiration dans le riche répertoire artistique du sud marocain. Ainsi, outre les charpentes traditionnelles en bois savamment enchevêtrés et richement peints et décorés qui ornent les salles des prières, l’essentiel du décor est fait d’éléments géométriques et floraux tracés et/ou peints en ocre sur enduit, gravés sur les ventaux des portes et les panneaux des minbars en bois ou exécutés en plâtre et en stuc sur les façades principales et les registres des mihrab.D’autres composantes du décor sont faites d’éléments architectoniques en pierre ou en bois taillés (consoles, corniches, frises …) ou en maçonnerie. On trouve aussi des compositions décoratives en brique de terre cuite à l’image des motifs recticurvilignes qui ornent les façades du minaret d’Akka.
Conclusion
Ce travail d’inventaire a démontré que nos connaissances sur le patrimoine architectural religieux du monde rural marocain sont faibles et que ce patrimoine souvent qualifié de mineur, recèle des chefs d’oeuvre incomparables et un savoir faire de valeur inestimable qui méritent toute l’attention de la part des chercheurs et des spécialistes. Les premières analyses comparatives entre les bâtiments religieux étudiés montrent que ces oratoires ruraux présentent des éléments et des traits communs qu’on retrouve dans l’architecture locale et qui perpétuent une tradition architecturale islamique très ancienne au Maroc. Elles font ressortir des dispositions et des compositions architecturales et décoratives remarquables. Il s’agit généralement de simples petites mosquées, souvent dépourvus de décors mais présentant parfois une belle parure surtout au niveau du mihrab, des toitures et des façades d’entrée. Ces oratoires sont tous dotés de nefs parallèles au mur de la qibla et de rangées d’arcades composées d’arcs plein cintre parfois brisés reposant sur des piliers de formes variées. Une disposition qui nous rappelle celle des premières mosquées marocaines, notamment celles de Fès. La tradition locale est omniprésente surtout au niveau des techniques et des matériaux de construction mis en œuvre (arcades en briques de terre crue, murs en pisé, charpente de style Tataoui…) mais surtout par l’intégration d’un certain nombre d’éléments originaux tel le muret reliant les deux piliers faisant face à la niche du mihrab. Cependant le caractère le plus frappant reste l’importance accordée aux salles d’ablutions qui sont parfois de dimensions très importantes et occupent des positions curieuses au sein des mosquées.
Des dispositions qui s’avèrent typiques à cette région de Tata à moins que l’extension du champ de la recherche vers les régions environnantes, notamment vers les provinces de Guelmim, Zagora et Chtouka Aït Baha, ne prouve le contraire. A quelques exceptions près, on note dans la quasi-totalité de ces oratoires ruraux l’absence de minarets et de cours. Ces dernières sont remplacées par de petites courettes qui font le plus souvent office de puits de lumières et d’aération.
Bien qu’elles prennent la forme de petits oratoires, la majorité de ces lieux de culte
ruraux jouaient le rôle de mosquées à khotba (à prône) où se tenaient la prière et le
prêche du vendredi. Certains ont cessé de jouer ce rôle en raison de l’absence de nos jours, dans les douars, de l’effectif minimal de fidèles fixé à 12 et exigé par la charia pour que cette prière puisse avoir lieu.
La majorité d’entre eux sont toujours fonctionnels alors que certains sont en état
d’abandon et ont cédé la place à des édifices modernes qui rompent complètement
avec une tradition architecturale séculaire. Ce phénomène ne fait pas l’unanimité des habitants des douars dont certains refusent de prier dans ces nouveaux oratoires.
Toutefois, malgré cet attachement jaloux des autochtones à ces anciennes structures
villageoises traditionnelles, on note un délaissement et une négligence qui font que
plusieurs oratoires finissent par se réduire en décombres. Ceci sans oublier l’état du mobilier (portes, charpentes, minbars…) qui est proie au vandalisme et un trafic illicite systématique qui ne cesse de s’amplifier dans la région.
Ce patrimoine culturel et cultuel en partie vivant nous interpelle tous aujourd’hui,
surtout que cette tradition architecturale bien ancrée dans l’histoire qui tire ses caractères des origines de l’architecture religieuse au Maroc et qui porte la marque de la spécificité locale, se trouve aujourd’hui menacée de disparition en raison de plusieurs facteurs. Ce constat alarmant incite tous les acteurs locaux et les départements concernés (Ministère de la culture, Ministère des Habous et des affaires islamiques…) à conjuguer leurs efforts afin de réfléchir sur les modalités de sauvegarde, de préservation et de transmission de ce patrimoine architectural et de ce savoir-faire ancestral aux générations futures ainsi que sur les possibilités qui s’offrent en vu de les mettre en valeur et de les exploiter de manière rationnelle dans le développement d’un tourisme culturel durable.
SOURCE WEB Ministère des Habbous Par les Pr. Mohamed BELATIK et Pr. Mustapha ATKI
Publié le lundi 18 juin 2007 12:26


 lundi 9 mars 2015
lundi 9 mars 2015 0
0 































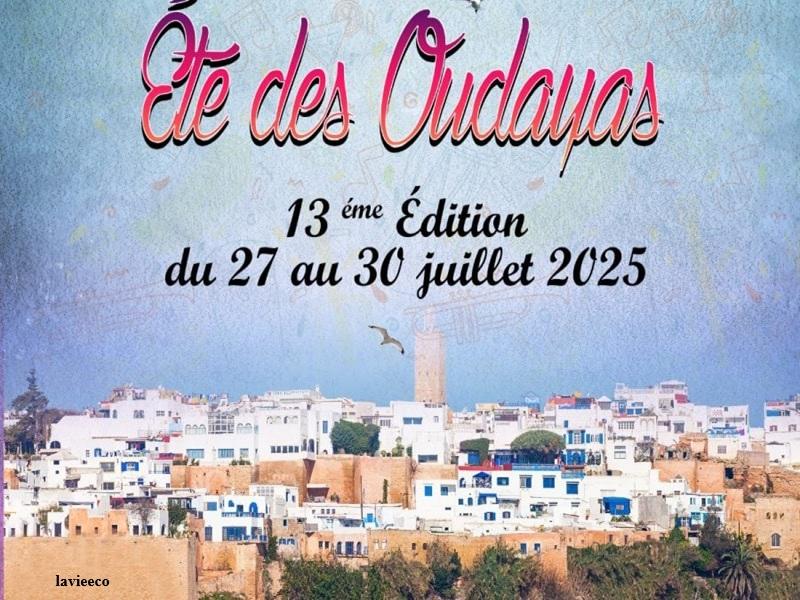

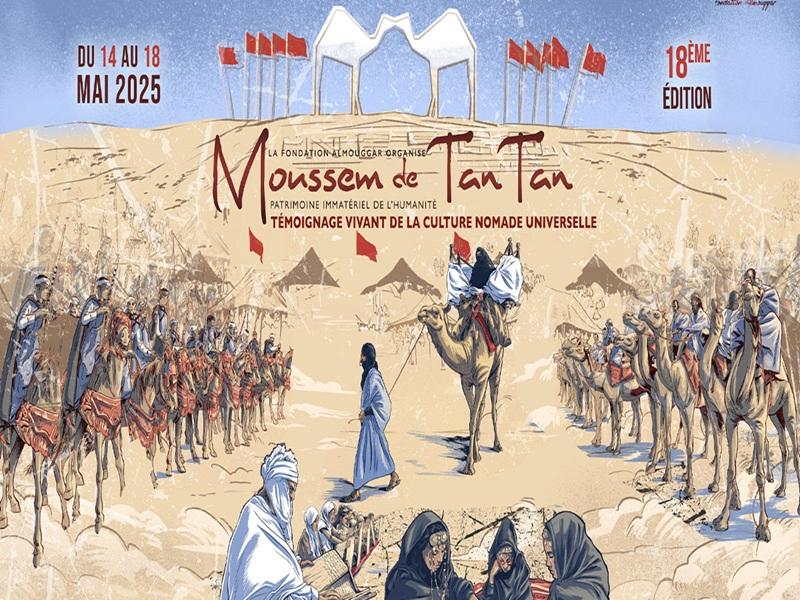








 Découvrir notre région
Découvrir notre région