Sud Maroc -Sècheresse - Agriculture oasienne : Un écosystème millénaire en déperdition

Dans les régions arides et semi-arides qui définissent l’économie oasienne, investie il y a dix siècles (depuis la deuxième arrivée arabe dans ces régions), l’implantation des palmeraies de manière intensive a été inclusive des populations berbères sur place.
Les palmeraies et la culture vivrière ont permis aux habitants de descendre des montagnes et de pratiquer une économie durable jusqu’à la fin du 19e siècle et le début du 20e, relève Patrick Simon. Le président de l’Association marocaine de développement du Géoparc Jbel Bani vit au Maroc depuis six décennies. Il a exercé au sein de la chambre de commerce française avant de s’installer à Tata, il y a de cela 13 ans.
Les activités de Simon dans le développement territorial et le géo-agro tourisme depuis 23 ans lui donnent l’occasion de travailler sur les sciences humaines et sciences de la terre, en partenariat avec des universités marocaines et écoles d’ingénieurs et d’architectes.
Forcés à l’exil «L’implantation du palmier par les Arabes a fait l’objet d’études d’impact sur la base d’études des bassins versants, réalisées il y a 2000 ans par les Maurétaniens basés à Tanger. Ces derniers avaient prospecté dans la région en marge du commerce d’or et d’argent», relève le président de l’association. L’eau disponible provient des nappes phréatiques dans cette région aride où il pleut rarement, et qui est également desservie par l’Anti-Atlas grâce au ruissellement.
Dans ces plaines désertiques de Tata où les palmiers n’existaient pas, les khettaras (un dispositif traditionnel de mobilisation de l’eau souterraine) datant de 5000-6000 ans sont importées d’Orient, Perse-Yemen.
La Khettara consiste à détourner l’eau dans les vallées voisines, d’amont en aval, pour reconstituer les nappes phréatiques. Ce système permet d’irriguer les palmiers dont la consommation s’élève à 300-400 l/jour pour un palmier adulte.
Au fil du temps, la population devient experte en creusement des galeries souterraines grâce au savoir-faire des khettaras. A la fin du 19e siècle, Français et Allemands vont se bagarrer pour réquisitionner les habitants, transformés en mineurs, afin de les faire travailler dans le nord de la France (la Mouzeil pour les charbonnages de France et la Ruhr en Allemagne). Leur départ détruit complètement la gestion hydrique et l’équilibre oasien, qui a également souffert des attaques acridiennes au cours du 20e siècle. Les luttes contre ces attaques avec des pesticides ont détruit, par mégarde, les abeilles sahariennes responsables de la pollinisation, selon Simon. Le renoncement à une économie durable avec une nativité élevée, et le parcellement des propriétés familiales, ont pour leur part réduit la rentabilité. L’abandon des techniques vivrières et agricoles qui existaient sur place pose un véritable problème, car l’économie oasienne représente 20% du territoire, avec 5 à 6 millions d’habitants qui se mettent sur le chemin des villes en l’absence de solution.
Des efforts anéantis par la sècheresse
Dès 1985, Myriam Drissi revient dans la palmeraie de Skoura (à 40 km de Ouarzazate) pour tenter de ressusciter l’autonomie de l’agro-écologie inspirée par Pierre Rhabi. Bon an, mal an, des formations sont organisées en faveur des familles afin de pérenniser leur installation dans l’oasis qu’elle a connue dans son enfance et qui se perdait à une vitesse vertigineuse. «Quand un arbre est mort, il n’est pas remplacé», regrette-t-elle.
Pour lutter contre l’exode rural, un modèle agricole est constitué sur place, avec un idéal d’autonomie à atteindre. «Nous avons déménagé plusieurs fois avant que le ministère de l’Agriculture ne nous fasse confiance et nous attribue un lopin de terre de 1.500 m, avec un accès au puits dans un centre de mise en valeur agricole abandonné. C’était un signe supplémentaire que quelque chose n’allait pas. Nous avons distribué des ruches à 200 femmes, mais aujourd’hui notre travail a été anéanti par la sécheresse», témoigne-t-elle. Le stress hydrique atteint des niveaux inquiétants. En 35 ans, les apports d’eau par habitant sont passés de 2.800 m3 à 500 m3.
Le 16/01/2025
Par Mounira LOURHZAL L'Economiste
www.darinfiane.comwww.cans-akkanaitsidi.net www.chez-lahcen-maroc.com
Les tags en relation
Les articles en relation

« Les villes africaines ont énormément de possibilités pour lutter contre le changement climatiq
Alors qu’Abidjan accueille une « COP des villes », Youba Sokona, vice-président du GIEC, estime que les élus locaux doivent « devenir des acteurs majeurs...

Aziz Akhannouch : Des mesures audacieuses pour soutenir le pouvoir d'achat des Marocains malgré les
Lors de la Rencontre nationale des administrateurs et cadres administratifs du RNI, organisée ce dimanche à Casablanca, Aziz Akhannouch, chef du gouvernement ...

Salon international du sport et des loisirs : Un rendez-vous incontournable pour les passionnés du
L’ambition du SISL est de s’installer en tant que rendez-vous international majeur et de marquer les esprits grâce a? la qualité des exposants locaux et i...
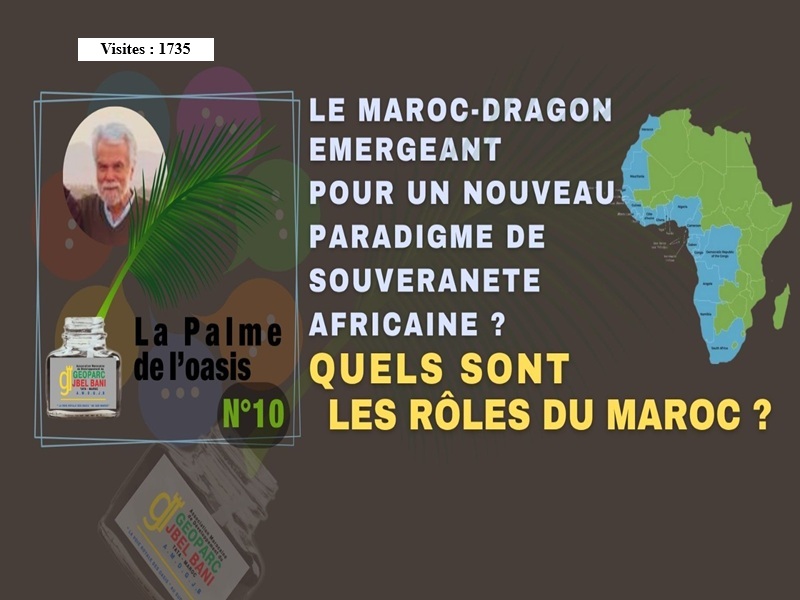
«La Palme de l'Oasis 10» LE MAROC-DRAGON EMERGEANT - POUR UN NOUVEAU PARADIGME DE SOUVERANETE AFRI
La Question posee d'un Maroc emergeant et du role du Maroc dans le cadre des ruptures geopolitiques actuelles est non seulement pertinente mais cruciale...

Future In Africa : Une 4e édition pour une meilleure gestion de l'eau grâce au digital
Sous le thème « Digital 4 Water : Le Digital pour une meilleure gestion de l’eau », Future In Africa revient pour une 4ème édition les 25 et 26 octobre 2...
.webp)
«La Palme de l’Oasis 16» MAROC : PLAN 2025-2028 PROGRAMME PROJETE DE 155 BARRAGES
L’AMDGJB PROPOSE LA STRATEGIE : DU BARRAGE-OUVRAGE AU BARRAGE-ECOSYSTEME ! Nous saluons l'initiative volontariste de Monsieur le Ministre de l'...

Province de Guelmim : La Foire régionale des dattes de Taghjijt du 17 au 20 octobre
La commune de Taghjijt (province de Guelmim) abritera du 17 au 20 octobre la deuxième édition de la Foire régionale des dattes de Guelmim-Oued Noun, placée ...

Top 35 des endroits secrets les plus envoûtants du Maroc qu'il faut à tout prix visiter
Guide des endroits les moins connus et les plus magiques du Maroc 1- Les montagnes d’Ichniwane dans la région de Nador 2- L’oasis d’Amtoudi à ...
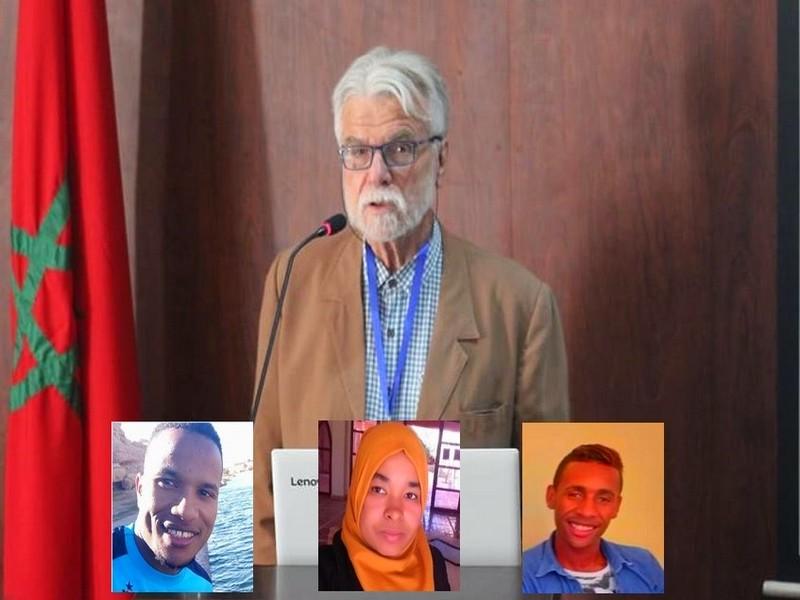
AMDGJB-GEOPARC Jbel Bani : à la recherche du patrimoine culturel qui compose son territoire !
Avec toute une équipe choisie IN SITU Selon les définitions du patrimoine culturel qui le compose comme suit : 5. Enoncé : «Le patrimoine culturel es...

#MAROC_FRUITS_ET_LEGUMES : Le marasme pointe son nez en attendant les pluies
La sécheresse, le recul des niveaux des barrages, la demande extérieure, les restrictions imposées par le gouvernement suite au coronavirus, la spéculation ...

Les récentes précipitations sauveront-elles la campagne agricole ? Un expert répond
Les agriculteurs ont vu leur moral boosté après les récentes précipitations, qui auront un impact positif sur le couvert végétal et les activités agricol...

Tata : Pressions des lobbies agricoles pour réautoriser la culture de pastèque malgré la crise de
Dans la province de Tata, au sein de la région de Souss-Massa, de puissants agriculteurs et lobbies du secteur agricole intensifient leurs pressions sur les au...


 jeudi 16 janvier 2025
jeudi 16 janvier 2025 0
0 










































 Découvrir notre région
Découvrir notre région