Sidattes. Le palmier dattier, opportunité ou fardeau ?

Rendez-vous incontournable des amateurs et professionnels de la filière phœnicicole, la 11e édition du Sidattes, inaugurée ce jeudi 27 octobre à Erfoud, met en relief un écosystème fragile et déterminant pour le développement économique des zones oasiennes, mais dont les besoins en eau augmentent la pression sur les ressources hydriques.
D’un moussem annuel organisé dans les années 1940, le Salon des dattes d’Erfoud (Sidattes) est devenu un rendez-vous incontournable, à portée internationale. Inaugurée ce jeudi 27 octobre, en présence de Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, la 11e édition du Sidattes est placée sous le thème de “La gestion intégrée des ressources naturelles”.
Organisé du 27 au 30 octobre 2022, à quelques centaines de mètres du centre-ville d’Erfoud, le Sidattes se déploie sur 40.000 m2, où 200 exposants nationaux et internationaux (Jordanie, Palestine, Mauritanie…) vont sensibiliser les 80.000 visiteurs attendus à un écosystème dont l’importance n’a d’égal que sa fragilité.
Cette 11e édition confirme également le développement et la popularité croissante d’un évènement “qui constitue une véritable vitrine de la richesse de notre patrimoine oasien”, s’est réjoui Mohammed Sadiki.
Les régions oasiennes occupent 38% du territoire national
Le palmier dattier est le symbole de cette richesse. Un arbre séculaire au Maroc, dont dépend le développement socio-économique des oasis des régions de Guelmim-Oued Noun, Drâa-Tafilalet, Souss-Massa et l’Oriental. Ces dernières occupent une superficie de 226.500 km², soit 38% du territoire national.
Sur le plan économique, la phœniculture contribue à hauteur de 40% à 60% dans la formation du revenu agricole dans les régions oasiennes et bénéficie à 2 millions d’habitants, en fournissant notamment plus d’un millions de journées de travail à 6.400 travailleurs permanents, à raison de 250 journées par an. Le PIB des zones oasiennes est quant à lui passé de 29,8 MMDH (2012) à 48,5 MMDH en 2020.
Bien que la culture de la pomme (400.000 t) truste le haut du classement en termes de production, la monographie agricole de la région de Drâa-Tafilalet, berceau des oasis marocaines (67%), est dominée par la culture du palmier dattier. Elle occupe 49.564 ha sur une surface agricole utile de 270.000 ha.
Les oasis de la région produisent en moyenne 128.000 tonnes de dattes, un fruit bénéfique pour la santé de par sa richesse en fructose, dextrose, saccharose et maltose. Il en existe plus de 400 variétés au Maroc, mais les plus prisées sont les dattes Mejhoul, Boufeggous, Nejda, Bouzekri et Aziza. Elles s’exportent également avec succès.
Le Maroc, 12e producteur de dattes au monde, a exporté 3.600 tonnes en 2020-2021. Si l’évolution de la filière semble constante, elle augmente néanmoins la pression sur les ressources hydriques.
Entre 15.000 et 20.000 m3 par hectare
Décrit par les spécialistes comme l’arbre le plus adapté aux conditions climatiques des zones oasiennes, marquées par des précipitations faibles et irrégulières, le palmier dattier nécessite toutefois un apport annuel en eau de 15.000 à 20.000 m3/ha pour atteindre une rentabilité optimale, selon l’Office nationale de conseil agricole (ONCA),
Le palmier dattier consomme donc bien plus d’eau que des cultures décriées comme celles de l’avocat (9.000 m3/ha) ou de la pastèque (6.000 m3/ha). Un écueil de taille dans une région où le taux de remplissage du stock des ressources hydriques est d’environ 20% (133 Mm3).
Ainsi, l’efficacité hydrique décrit un enjeu majeur. La stratégie Génération Green compte y remédier comme suit :
– la sauvegarde des ressources en eau souterraines (cas de la nappe de Meski-Boudnib) ;
– la valorisation des terres collectives dans les zones oasiennes ;
– la préservation des périmètres de Petite et moyenne hydraulique (PMH) dans les oasis ;
– la sauvegarde du patrimoine des khettaras.
Dans ce cadre, les investissements prévus portent sur :
– la valorisation des eaux mobilisées par le barrage Kaddoussa pour le développement et la pérennisation de l’irrigation sur 10.000 ha ;
– la réhabilitation de 245 khettaras relevant des zones oasiennes sur un linéaire total de 405 km ;
– la réalisation des seuils pour la recharge des nappes et le renforcement de la mobilisation des eaux de surface ;
– la poursuite des efforts de reconversion des systèmes d’irrigation traditionnels à l’irrigation localisée ;
– la promotion de jeunes entrepreneurs dans les métiers de l’irrigation.
Des incendies en hausse
Le stress hydrique n’est pas l’unique menace qui pèse sur les oasis. Les 70 kilomètres qui séparent Errachidia d’Erfoud sont bordés par l’oasis d’Aoufouss. Une oasis d’une rare beauté mais dont les palmiers dattiers sont en majorité noircis par les flammes.
Selon l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), les oasis du Maroc ont été affectées par 2.191 incendies entre 2009 et 2021, l’équivalent de 994 ha et 135.743 palmiers incendiés.
En 2022, les oasis ont été victimes d’une trentaine d’incendies. Environ 200 ha. Au-delà du taux moyen de reprise des palmiers dattiers qui atteint 82%, “les incendies ne mettent pas pour autant en péril la production”, nous explique un acteur de la filière. Ce dernier va encore plus loin en affirmant que “mettre le feu aux oasis est une technique ancestrale qui permettait aux palmiers de se régénérer”.
Selon les acteurs de la filière sondés, cette technique est tombée dans l’oubli, et l’ensemble des incendies qui ont atteint les oasis de la région étaient involontaires. Une problématique dont le ministère de l’Agriculture espère réduire les conséquences avec la mise en place d’un plan pour régénérer les oasis et soutenir le développement de la filière.
Création de nouvelles exploitations de moins de 5 ha
Grâce au programme de plantation de 3 millions d’arbres de palmier, lancé en 2009 dans le cadre du Plan Maroc vert, la base de sauvegarde de ce patrimoine “universel a été renforcée, à travers la reconstitution et la densification des palmeraies”, précise le ministère de l’Agriculture.
Autres mesures importantes, “l’introduction de techniques et de technologies agricoles adaptées pour la conduite phœnicicole, tels la pollinisation et le nettoyage des touffes, ainsi que la création de nouvelles exploitations de moins de 5 ha au profit des filles et fils d’agriculteurs”, ajoute Mohammed Sadiki.
Dans la lignée du Plan Maroc vert, la stratégie Génération Green accorde également une importance capitale à l’élément humain, notamment via un programme de plantation de 5 millions d’arbres de palmier dattier à l’horizon 2030.
“Un contrat programme est en phase d’établissement avec la Fédération interprofessionnelle marocaine des dattes (Fimadattes). Il mobilisera l’ensemble des acteurs le long de la chaîne de valeur autour du programme de développement de la filière”, conclut Mohammed Sadiki.
A la lumière de ces éléments, le poids de la filière phœnicicole n’est plus à prouver, d’autant que les oasis qui accueillent ces arbres si particuliers sont des boucliers contre la désertification qui menace non seulement la filière phare, mais aussi les cultures de pomme, de rose, de safran et d’amande de la région.
Le 28/10/2022
Source web par : medias24
Les tags en relation
Les articles en relation
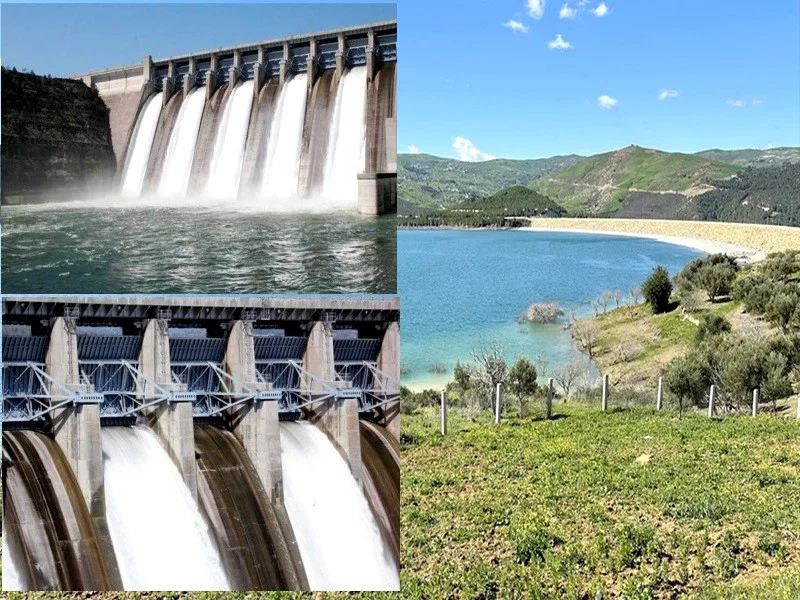
Comptage des gouttes d'eau : Les réservoirs du Nord ne sont remplis qu'à 42%
La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima fait actuellement face à une baisse significative des précipitations, ayant un impact direct sur le niveau de remplis...

L’agriculture marocaine face à un manque d’eau structurel : quel diagnostic ? Un expert répond
L’agriculture marocaine, impactée par un manque d’eau devenu structurel, se divise en deux domaines, distincts, mais complémentaires : le pluvial et l’i...

ANDZOA : nouvelle stratégie pour les zones oasiennes et montagneuses
L’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) a dévoilé une nouvelle stratégie de développement territorial vi...

Stress hydrique : le roi Mohammed VI préside une séance de travail
Voici un communiqué du Cabinet Royal : « Le roi Mohammed VI a présidé, ce jour au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à la problém...

Maroc : un projet national pour renforcer la sécurité et la durabilité de l’eau face au changem
Confronté à une pression croissante sur ses ressources hydriques, le Maroc lance un projet d’assistance technique nationale pour renforcer la résilience et...

L’industrie marocaine inaugure une nouvelle ère
Un message Royal trace la voie du secteur lors de sa première journée nationale Industrie : La tenue de la journée nationale de l’industrie, initiée co...

Argan : ce produit précieux dont le Maroc veut mieux maîtriser la filière
Face aux défis liés au succès international de l'argan, le Maroc s'emploie à mettre en œuvre une meilleure inclusion économique et sociale de sa p...

OMM : Cycle de l’eau gravement perturbé en 2025
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) alerte sur un dérèglement alarmant du cycle de l’eau à l’échelle planétaire. En 2024, année la plus c...

Le retard des pluies n’affectera pas la saison agricole
Le ministère dispose de plusieurs programmes pour accompagner les agriculteurs Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rura...

Les gadiris boivent désormais de l’eau dessalée de la station Chtouka-Aït Baha
La station de dessalement de Chtouka-Aït Baha vient d’entrer en service avec la livraison, samedi, des premiers volumes d’eau dessalée destinés à l’al...

One Ocean Summit: Akhannouch rappelle et défend les engagements du Maroc
Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, vendredi à Brest, lors du segment de haut niveau du premier Sommet international sur les océans "One Ocean Summit". ...

Maroc : OCP investit 6 MMDH dans le dessalement
OCP Green Water (OGW), filiale du groupe OCP dédiée à la production d’eau non conventionnelle, a levé 6 milliards de dirhams (620 millions de dollars) aup...


 mercredi 2 novembre 2022
mercredi 2 novembre 2022 0
0 










































 Découvrir notre région
Découvrir notre région