Entretien avec Pierre Bonte par Farida Moha

«J’ai voulu réhabiliter Saqiya Al-Hamra dans le mouvement des cultures, des sociétés, des hommes à travers l’Ouest saharien»
Pierre Bonte, directeur de recherche émérite du CNRS, membre du Laboratoire d’anthropologie du Collège de France
Pierre Bonte (né en 1942) est un ethnologue français. Il est directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), rattaché au Laboratoire d’anthropologie sociale (EHESS/CNRS/Collège de France, Paris). On retiendra parmi les très nombreuses publications de Pierre Bonte le «Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie», aux éditions des PUF, un ouvrage de référence co-dirigé avec Michel Izard qui a été traduit en arabe. Pierre Bonte vient de publier «La Saqiya Al Hmara, Berceau de la culture ouest-saharienne».
Pierre Bonte.
Le Matin : Vous êtes directeur de recherche émérite du CNRS, membre du Laboratoire d’anthropologie sociale au Collège de France. Vos recherches et travaux se sont étalés de 1970 à 2012. Qu’est-ce qui explique cette passion ?
Pierre Bonte : J’ai un mérite, celui de l’ancienneté. J’ai fait, en 1969, mon premier séjour dans l’Ouest saharien pour localiser la société bidan en Mauritanie. J’avais été à l’époque appelé par le Président Mokhtar Ould Daddah et le président directeur de la MIFERMA après les grèves de 1968 qui ont été cachées par un autre événement, celui de Zouerate qui avait entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes. J’avais déjà travaillé sur le monde touareg et je me suis retrouvé à Zouerate avec un programme de recherche pour comprendre pourquoi l’industrie minière avait du mal à être assimilée par les bidans.
Vous êtes dans la lignée des grands chercheurs comme Theodore Monod et Vincent Monteil qui, après avoir officié dans la région de Goulimine avait pris sa relève à la direction de l’Institut fondamental d’Afrique noire, connu pour sa traduction d’Ibn Khaldoun et ses recherches sur l’Islam ?
J’ai bien connu Vincent Monteil qui s’était converti à l’Islam et qui est décédé en Mauritanie de manière très humble et discrète. J’ai également connu Theodore Monod, une grande figure de la science du XIXe siècle, au savoir universel. C’était au départ un océanographe, un géologue et son apport aux sciences sociales et humaines est capital.
À propos des sciences sociales, comment peut-on définir l’anthropologie, qui regroupe elle-même plusieurs disciplines comme la linguistique, la sociologie... ?
C’est un long débat, l’anthropologie travaille sur la globalité en se saisissant des différentes sciences sociales. En fait, tout est lié, la religion, la politique...
Dans un de vos articles sur l’anthropologie et l’éthique, vous parlez du «relativisme culturel». Qu’entendez-vous par ce concept ?
Le relativisme culturel, c’est un peu le fondement épistémologique de notre démarche. Ce relativisme signifie qu’il n’y a pas une culture qui soit meilleure que l’autre. Elles sont toutes relativement différentes, postulat auquel l’anthropologue ajoute qu’elles sont toutes différentes, mais qu’elles parlent du même homme, au-delà des thèses dites racistes ou des thèses civilisationnelles qui ont fleuri avec la colonisation. Des thèses qui ont malheureusement encore de beaux jours à vivre sur le plan de la politique. Sur le plan scientifique, ces concepts sont évacués, plus personne ne prend encore au sérieux ces concepts de race, sachant toutes les distributions génétiques avec les formes intermédiaires. Le métissage étant la forme la plus évidente. Le découpage que l’on fait sur la couleur de la peau est parfaitement démenti dans les sociétés sahariennes qui nous intéressent. Les unions d’antan avec les esclaves ont fait que les gens riches qui étaient blancs ont noirci au fil du temps. Les gens qui n’avaient pas d’esclaves restaient entre eux et gardaient leur teint de berbère. On voit bien par cet exemple que ces idées hiérarchiques liées à la race n’ont aucune signification, ni de sens commun. Au XVIIIe siècle, les Américains disaient que les noirs étaient prédisposés à l’esclavage, ce sont ces mêmes noirs qui dirigent des pans entiers, qui sont influents et nous avons même le Président Obama.
Avec Saqiya Al Hamra, alors que l’on craignait la mainmise des juristes et politologues, vous renouez avec la tradition culturelle et celle des sciences humaines. Quelle est l’histoire de ce livre ? Pourquoi une telle importance accordée à cette région précise de cet immense Sahara comme vous l’écrivez ?
C’est l’histoire d’un manque, une curiosité dans ma démarche, j’ai beaucoup travaillé en Mauritanie sur les sociétés tribales qui structurellement sont identiques dans tout l’Ouest saharien, avec certains traits particuliers. On peut les rapprocher des Touaregs, mais ils sont arabophones, ce sont des sociétés tribales qui sont pastorales, nomades… Il y a une série de traits et l’on s’aperçoit que l’histoire a fait émerger des politiques relativement différentes. J’ai fait ma thèse d’État sur «les Émirs de l’Adrar» qui ont mis en évidence les structures les plus visibles. J’ai essayé de reconstituer historiquement les processus politiques et de les analyser anthropologiquement. On a affaire à des formations sociales originales qui n’existent pas partout dans le monde Bidan. Si vous allez vers l’Est, vers ce que l’on appelait le Soudan français d’autrefois, vous trouverez d’autres types de formations politiques avec des chefferies éphémères qui se battent, se combattent, sont toujours en compétition, parfois se succèdent. L’un des exemples, c’est les Ouled M’Barek qui ont marqué la culture arabe des Bidans rattachée à la tradition hilalienne. J’ai travaillé sur ces régions et dans le Nord où il y avait encore des sociétés différentes du point de vue de leur organisation sociopolitique.
Ce sont les Rguibats par exemple, qui sont les plus nombreux, ou d’autres sociétés peu stratifiées assez égalitaires, et sans chefferie bien marquée. J’ai voulu poursuivre mon analyse dans cette perspective comparative de ces différents types de formation sociopolitique. Le deuxième intérêt pour moi, et de manière toujours comparative, c’était de voir comment ces sociétés s’étaient adaptées dans la modernité à l’apparition de nouvelles formes d’État. La plupart des États de cette région étaient des États coloniaux créés par la colonisation. Dans leur dimension postcoloniale, ils en gardent certains traits comme en témoigne l’héritage des frontières au Mali. Avec cette exception du Maroc qui était un État bien avant le protectorat et qui a une très vieille tradition dans ce sens. Dans ces situations différentes, j’ai voulu voir comment cette articulation du monde tribal et des États modernes se développe de manière originale avec des situations locales qui sont différentes. Le tribalisme en Mauritanie et le tribalisme au Sahara marocain ne prennent pas les mêmes formes à cause du passé des Tribus, mais aussi à cause de la manière dont elles vont être instrumentalisées par l’État et dont elles vont, elles-mêmes, instrumentaliser l’État.
Avec les mutations apportées par l’urbanisation, pensez-vous que l’on assiste au «Dernier nomade» du titre d’un de vos ouvrages publié en 2004 ?
L’urbanisation est un phénomène général dans toute la zone. Le livre «le Dernier nomade» est une étude somme toute générale qui étudiait une vingtaine de sociétés pastorales nomades. Elle rend compte de la décomposition des valeurs et des structures sociales des tribus. J’avais pris l’exemple des tribus de la Mauritanie et des Touaregs qui ont fait l’objet de ma thèse de troisième cycle qui portait sur les Touaregs du Niger.
Qu’y a-t-il de commun entre les tribus sahariennes et les tribus touarègues ?
Quand on parle de Bidans, on en parle en opposition avec Soudan. Dans ces sociétés, ce qui est mis en avant, ce sont des phénomènes de domination et d’esclavage.
Qui n’existent plus ?
Qui n’existent
plus, mais on continue à savoir qui sont les anciens esclaves et qui sont les
maîtres. En Mauritanie, c’est toujours un sujet à l’ordre du jour avec la
grande marche d’un leader des Harratines qui sont des affranchis qui réagissent
plus comme d’anciens agriculteurs qui n’avaient pas accès à la terre.
L’esclavage a été supprimé à l’époque du Président Haidallah et la loi foncière
avait été transformée en même temps de manière à permettre l’accession de ces
groupes à la propriété par le biais des coopératives. Autrefois, ils n’avaient
accès à la terre que par le biais des Tribus qui étaient dominées par les
Bidans. Cela crée des situations qui mélangeaient les raisons politiques et
religieuses devant la zakat par exemple.
Quelles sont les autres raisons qui motivaient votre intérêt pour Saqiya Al
Hamra ?
C’est une région qui a été négligée dans la recherche scientifique pour des
raisons d’ordre politique. C’était le Sahara espagnol dont on ne savait pas
grand-chose jusqu’aux années cinquante. À part les recherches d’un
anthropologue espagnol Caro Baroja, le terrain était vierge. Il fallait une
sorte de réhabilitation de la place historique de cette région dans le mouvement
des cultures, des sociétés, des hommes à travers tout l’Ouest saharien, car
c’est une région où tout le monde est passé.
Vous l’écrivez dans votre avant-propos «Bien avant Smara, le nom de Saqiya Al Hamra était déjà connu et vénéré, entouré de ce halo de mystère accompagnant les saints personnages qui y auraient vécu, descendants du Prophète, réformateurs de l’Islam et fondateurs de tribus jusqu’en Tunisie et en Libye actuelles.»
Oui, il y a eu des influences des tribus du Maghreb des montagnes, des steppes, qui ont adopté pour pouvoir survivre, des modes de vie différents de celui des gens des oasis ou des cultivateurs berbères. Il y a eu plusieurs vagues berbères qui se sont succédé comme celle des Znaguas, ensuite les Beni Hassan qui ont donné leur nom à la langue Hassania. De la rencontre de ces mondes est née la société Bidan qui a gardé des traits du monde berbère. D’où le rapprochement que l’on peut faire avec le monde des Touaregs qui sont d’origine Sanhadjas. Les Massoufas, par exemple, qui sont des branches importantes des Sanhadjas sont à l’origine de nombreuses tribus touarègues. Il y a eu aussi des apports de tribus de l’Est. La société Bidan est une création originale vers le XVe et XVIe siècle de la fusion de ce mélange de sociétés avec leur culture et leur organisation sociale.
Quelles sont les spécificités de cette organisation sociale ?
Le lettré de
berbérité si l’on peut dire ce n’est pas la langue, c’est le statut de la femme
sahraouie. Quand je me promène le soir dans les rues de Dakhla ou Laayoune, je
vois des jeunes femmes qui comme dans la culture espagnole, se promènent en
groupe. Quand je suis invité dans les familles sahraouies, les femmes mangent
avec nous, discutent en dehors de toutes les formes d’évitement que l’on peut
rencontrer ailleurs. Nous sommes aussi dans la monogamie. Dans les clauses des
contrats de mariage, il y a quasi généralement le fait que la femme doit rester
la seule épouse. Une deuxième épouse n’est possible qu’en cas d’accord de la
première, c’est vous dire que c’est de l’ordre de l’impossible… C’est aussi une
société où l’on divorce beaucoup et le divorce contrairement à ce qui se passe
dans d’autres régions du Maghreb n’est pas un stigmate. Au contraire, c’est une
forme de conquête de liberté pour la femme.
Avec l’urbanisation on assiste à une véritable mutation des modes de vie.
Quels sont les changements opérés au cours de ces trois ou quatre dernières
décennies qui vous ont le plus frappé ?
Ce qui a le plus évolué c’est le mode vie. Quand j’ai commencé à travailler en 1967 en Mauritanie, il y a eu un recensement où l’on estimait qu’il y avait 70% de la population nomade qui vivaient sous la kheima. Actuellement, il y a à peine 3 à 4% qui vivent sous la Kheima, même chose au Sahara. Dans les provinces de Laayoune ou Boujdour, 95% de la population vivent en villes ! Il y a la ville et le désert. En Mauritanie, cette très forte urbanisation ne s’est pas révélée négative pour les valeurs du pastoralisme, car il existe ce que l’on appelle les «tentes secondaires» situées à une centaine de kilomètres de la ville, avec un petit troupeau, qui accueillent parfois une autre épouse ! Il faut rappeler que la ville de Nouakchott est passée de 30 000 à 300 000 habitants en une année !
On ne retrouve plus ce mode de vie au Sahara après la sécheresse des années 70 et pour des problèmes de sécurité. La culture sahraouie conserve d’autre part ses particularités qui lui donnent un style propre.
Avec une forte inflexion religieuse. Saqiya Al Hamra est une terre de saints, de chérifs comme vous le rappelez dans l’ouvrage ?
Tout à fait, c’est une terre de chérifs, des Rguibats par exemple, des chérifs qui ont été des modèles de référence pour négocier cette convention du monde berbère et arabe. Les gens se sont regroupés autour d’eux et c’est autour de leur arabité particulière d’origine prophétique que s’est organisée cette fusion qui a effacé les différences.
En fusionnant toutes ces données, peut-on comprendre l’impasse politique actuelle du Sahara ?
C’est une question compliquée que l’ONU a mal posée en 1975 au moment où le Maroc a saisi la Cour internationale de La Haye en distinguant une souveraineté sur les Hommes sans souveraineté sur le territoire. On reconnait les relations entre les populations et l’État, mais ces relations n’impliquent pas, selon l’ONU, une souveraineté sur le territoire. C’est une forme qui rend les négociations impossibles et qui rend très difficile toute évolution de la situation sur le plan international. Le problème est mal posé parce qu’il le pose en des termes qui distinguent population, territoire et souveraineté. Cela obéit à des notions de droit occidental, mais cela ne rend pas compte de phénomènes comme celui de l’allégeance qui est très difficile à interpréter, ou de la dimension religieuse. Ces concepts sont difficiles à incorporer dans le droit international, même si l’on sait que les populations ouest-sahariennes, qui sont des populations libres, reconnaissaient une forme d’allégeance pour éviter une perte de la diversité comme je vous l’ai expliqué.
L’ouvrage de «la Saqiya Al Hamra, berceau de la culture ouest-saharienne» est un très beau livre de près de 350 pages, qui comprend des photos admirables au vrai sens du terme. Les éditions la Croisée des chemins ont réalisé un travail remarquable.
Oui la mise en page est aussi très bien faite et le livre restitue l’apport de cette région qui s’est trouvée un moment marginalisée par les autorités coloniales espagnoles. On voit bien à travers l’ouvrage les vagues successives des populations pastorales, mais aussi la fluidité de cet espace qui permettait la circulation des biens et des idées. J’ai rappelé les faits historiques et la proximité avec les Iles Canaries qui ont un passé berbère, phénicisé, christianisé, islamisé. On sent toutes ces différences avec le statut de la femme et avec la dimension de la Tasufrat, ce sac emblématique qui aux Canaries est un peu plus petit qu’au Mali ou en Mauritanie, parce qu’aux Canaries le bétail est plus petit. Depuis la mort de Franco, les Canariens ont fait un gros effort d’investigation et la plupart se sont découverts berbères ! Beaucoup de travaux archéologiques ont été lancés et on a une plus grande connaissance des origines. J’ai essayé aussi de montrer que cet espace de Saqiya El Hamra était un lieu de passage où on a même retrouvé des pièces romaines. Dans ce livre, j’ai aussi remis en cause beaucoup d’idées reçues et je me suis intéressé à l’époque moderne en m’arrêtant à 1975 et en insistant sur l’Armée de libération nationale et sa place politique.
En définitive, nous sommes encore dans un processus de décolonisation qui n’est pas achevé, même si la présence du Maroc est irréversible.
Irréversible avec l’urbanisation ?
Le Maroc a consenti de tels investissements qu’on le voit mal renoncer à ses provinces.
Et puis il y a le Mali ? Vous ne pouvez pas réclamer l’intégrité territoriale du Mali, alors que les Touaregs demandent l’indépendance depuis les années 1960, et exigent un référendum au Maroc qui propose l’autonomie...
Il y a ce leitmotiv de l’histoire moderne des frères ennemis représentés par l’Algérie et le Maroc. Tout est venu à travers ce prisme et le Maroc a eu la malchance d’être colonisé trop tard. Si le Maroc avait été colonisé avant l’Algérie, il aurait gardé son Sahara et peut-être même plus, avec le Sahara oriental, le Touat, la Saourat. C’est l’Algérie française qui a changé les frontières et les deux administrations coloniales du Maroc et de l’Algérie se disputaient même Tindouf, occupé en 1934, qui a fait l’objet de plusieurs négociations !
Histoire et sociétés du Maroc saharien
La collection «Histoire et sociétés du Maroc saharien» a été créée par l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du sud du Royaume afin d’alimenter la bibliographie nationale sur le Maroc saharien. Partant du constat alarmant de la pléthore de documents à caractère géopolitique et du faible intérêt porté aux aspects culturels et patrimoniaux, la collection «Histoire et sociétés du Maroc saharien» ambitionne de faire connaître les richesses culturelles des provinces du sud et la multiplicité des thématiques ayant trait à leur patrimoine. En abordant ces sujets, la collection s’appuie fortement sur la valorisation de l’identitaire de ces territoires tout en contribuant à faire dissiper les clichés prégnants et réducteurs de cette composante de notre culture nationale. Elle constitue aussi une plateforme importante pour accumuler les recherches et les connaissances sur les savoir-faire et savoir-être du Maroc saharien. Ces données constituent une opportunité scientifique pour accompagner les chantiers du développement intégré des provinces du Sud du Royaume : la maîtrise des informations et des renseignements sur les composantes patrimoniales et identitaires de ces territoires est appelée à être un pilier important dans la documentation, la programmation, la conception et l’adaptation des projets (économie sociale, artisanat, produits de terroir, communication…).
Publié le : 7 Mars 2013 –
SOURCE WEB Par Farida Moha, LE MATIN
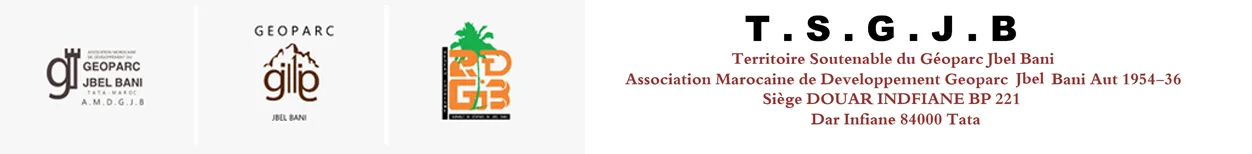

 mardi 21 mai 2013
mardi 21 mai 2013 0
0 



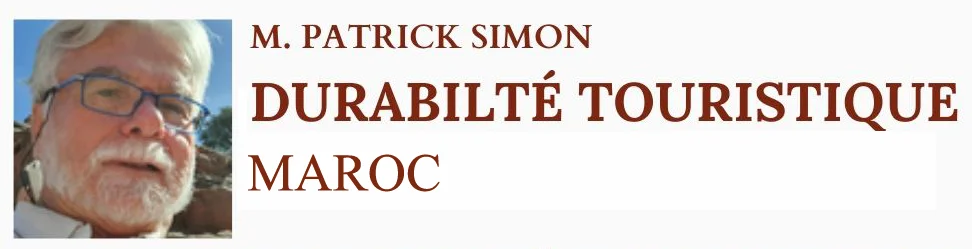







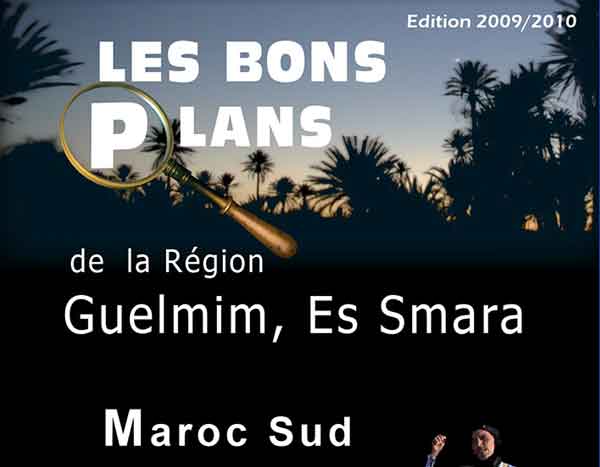






























 Découvrir notre région
Découvrir notre région