Forum Urbain Mondial (2 -2) : à quoi ressembleront les villes de demain ?

ENTRETIEN | Le Forum Mondial Urbain s'ouvre à Medellin samedi 5 avril. Seconde partie de notre entretien avec Daniel Biau, ancien directeur de l’Agence de l’ONU pour les villes.
Vue du Caire (© KHALED ELFIQI/EPA/MAXPPP)
Le 7e Forum Urbain Mondial va réunir près de 10 000 participants pendant six jours à Medellin, Colombie, à partir du samedi 5 avril. Tous les deux ans, cette immense conférence internationale permet à tous les acteurs de la vie dans les villes (des plus riches aux plus démunies) de faire le point sur des questions brûlantes comme la surpopulation, l'extrême pauvreté, les besoins en eau...
Le Français Daniel Biau a été à l'origine de ce rendez-vous majeur qui réunit des ingénieurs, des urbanistes, des élus, des associatifs. Aujourd'hui jeune retraité, Biau a été l’un des directeurs de l’Agence de l’ONU pour les villes, dont le siège est à Nairobi. Pendant vingt ans, cet ingénieur civil et docteur en sociologie a conseillé les dirigeants de pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine et d’Europe Orientale en matière de politiques du logement et de développement urbain. Voici la deuxième partie de notre entretien (retrouvez ici la première partie).
Existe-t-il,
en ce début de 21e siècle, un plan-type de ville qui fonctionne bien, un modèle
?
Il existe des principes et des besoins universels : par exemple concernant
l’accès au logement ou à l’eau potable. Sur ces sujets les Nations Unies
produisent ce qu’on appelle des « lignes directrices », que les villes, les
gouvernements locaux sont invités à appliquer dans leurs contextes
particuliers. Il y a aussi des principes universels en matière de finances
municipales, et un consensus autour de l’idée que les transactions et les
plus-values foncières doivent être taxées – même si hélas cela ne se fait pas
partout dans le monde.
Quels
sont les débats qui animent actuellement le monde des spécialistes de
l'urbanisme ?
La plupart des experts estiment qu'une ville, pour bien fonctionner, doit être
dense. C'est ce qu'on appelle « la ville compacte », avec l'idée d'y réduire les
déplacements, donc la pollution. Mais ensuite, il y a débat : la ville
doit-elle être dense mais polycentrique, c'est-à-dire dotée de plusieurs poches
de densité reliées les unes aux autres ? Ou bien doit-elle être mono-centrique,
sur le modèle français ?
Un quartier du Caire (© Mark HENLEY/PANOS-REA)
En Asie, la tendance est au développement de villes polycentriques : on évite de tout mettre au même endroit. Mais pour autant, la ville, même polycentrique, se doit de rester dense ! Beaucoup de citadins africains rêvent de conserver la campagne en pleine ville, des espaces pour planter et récolter en milieu urbain, mais ce serait aller contre ce nécessaire principe de densité. L’agriculture urbaine est mythifiée : on voudrait à la fois le beurre et l'argent du beurre, les avantages de la ville et une ruralité préservée. Combien de parisiens voudraient avoir un jardin, faire pousser des tomates ? Ce n'est hélas pas réaliste, du moins à grande échelle.
Vous avez passé votre vie à voyager. Vous arrive-t-il encore d'être surpris par des villes ? En bien, en mal ?
Comme je le disais, les villes chinoises ont été plutôt bien modernisées. Le drame, c'est qu'elles ont perdu leur âme depuis qu'on y a détruit les traces du passé... Il y a aussi des villes que j'aime bien qu'elles ne soient pas très « glamour ». Le meilleur exemple, c'est Le Caire, une ville critiquée pour sa poussière, son bruit, ses embouteillages. J'y vais souvent depuis 1973 et j'y trouve toujours des raisons de me réjouir. J'aime son mélange incroyable, sa vie sociale dans les quartiers qui est extrêmement dynamique. Et puis Le Caire a mille ans d'âge, c'est LA grande capitale du monde arabe. Une merveille d'imagination urbaine, de convivialité. La ville, c'est une création collective, souvent inorganisée, non planifiée, et qui donne souvent quelque chose de magique.
C'est un point de vie étonnant venant d'un ingénieur comme vous : la non-organisation, l'improvisation, peuvent trouver grâce à vos yeux ?
Oui, quand elles autorisent des améliorations postérieures proposées par des urbanistes. Le plus important, dans une ville, c'est la vie, ce sont les gens, et les strates de l’histoire. Regardez Istanbul : là-bas aussi, on construit souvent sans permis, on contourne les lois, les règles... Et pourtant, voilà l'une des villes les plus spectaculaires du monde. Istanbul, c'est une merveille. J’ai exploré mes villes préférées, leur histoire et leur présent, dans un récent ouvrage (1). On y trouve Paris, New York, Rio, Sydney, Istanbul, Rome, Amsterdam, Prague, Budapest, Le Caire, Ispahan, Hanoi, et même Calcutta. Allez dans ces villes, elles stimuleront votre imagination et vous rendront admiratifs de tout ce que les sociétés humaines ont pu et peuvent réaliser de plus beau et de plus complexe.
Une rue de Hanoi
La
France a une longue tradition d'expertise dans l'urbanisme comme dans le génie
civil. Les ingénieurs français jouissent-ils toujours d'un statut particulier
dans le monde ?
Les Français sont reconnus en génie civil. La première école d’ingénieurs a
ouvert en 1747 à Paris, sous le règne de Louis XV, sous l'impulsion de Trudaine
! Avec les Anglais, nous avons toujours été en pointe, suivis et dépassés
depuis le début du XXe siècle par les Américains. Aujourd'hui, bien sûr, tout
le monde construit des ponts, en particulier les Japonais et les Chinois, mais
l'ingénierie française en la matière reste extrêmement appréciée. De même pour
tout ce qui touche aux transports, les métros, les tramways.
Notre expertise est également reconnue dans ce qu'on appelle « les services urbains », les services des eaux, les partenariats public-privé. Depuis Hausmann, on peut dire qu'une certaine idée de gestion de la ville à la française a fait école. Les Français, pour citer deux exemples, ont fait le plan d'urbanisme du Caire à la fin du XXe siècle, et celui d'Istanbul en 1930. Ces deux dernières décennies, les Français ont aussi développé de nouvelles approches, des méthodes consultatives : la Communauté Urbaine de Lyon, par exemple, a beaucoup questionné sa population sur les choix urbanistiques, plutôt que de s'en remettre aux décisions de technocrates. Cette nouvelle approche apparue dans l'hexagone est un modèle de plus en plus accepté de par le monde. On sait maintenant que pour améliorer la ville, ou un morceau de ville, il faut impliquer les acteurs du quotidien, les habitants, et tout le tissu socio-économique.
On
entend pourtant souvent dire que le savoir-faire à la française perd de son
influence...
Le risque, c'est celui d'une certaine suffisance, voire arrogance. Trop
souvent, nos experts, nos entreprises, laissent entendre que « si ça marche en
France, alors ça marchera ailleurs ». C'est vrai que nous avons une expertise
technique et une force conceptuelle, mais il faut garder en tête qu'elles
doivent être adaptées à des contextes différents. J'ai souvent l'impression que
les Français, dans leur rapport aux pays étrangers, manquent de modestie, se
posent en donneurs de leçons.
Il faut travailler avec les experts locaux, les respecter ! Les vieux pays coloniaux ont tendance à tomber dans la suffisance, alors que les nouveaux acteurs comme les Brésiliens et les Chinois, ou évidemment les Américains, sont beaucoup plus diplomates, plus respectueux ou plus astucieux. Nous sommes parfois réticents quand il s'agit de collaborer avec d’autres pays européens sur un projet spécifique. Nous nous vivons trop en concurrence avec les autres. Les pays nordiques, eux, savent faire des alliances.
Dans les dossiers dont vous aviez la charge à l'ONU, vous avez personnellement été le témoin de cette suffisance française ?
A maintes reprises, dans les instances internationales, lors de grandes conférences, des moments où il fallait négocier des textes, des accords, oui, j'ai trouvé que les délégations françaises étaient un peu hautaines, sans doute du fait de l’aura incontestable de notre pays. Etant représentant du secrétariat de l'ONU, donc neutre, des délégations étrangères venaient parfois me trouver discrètement et me disaient : « Dites-donc, vous pourriez dire aux Français de se calmer un peu ? »
Quel parcours personnel vous a mené jusqu'à l'Agence des Villes ?
L'Agence des Villes, c'est notre nom d'usage, mais le nom officiel, c'est ONU-Habitat (en anglais : UN-Habitat)... De formation, je suis ingénieur des Ponts et Chaussées – puis j'ai fait un doctorat de sociologie africaine à La Sorbonne. Gamin, j'avais vécu au Mali... J'ai toujours beaucoup voyagé. Jeune étudiant, stagiaire, je partais en Afrique, en Chine, en Egypte, au Mexique, j'avais cette passion des villes, des modes d'habiter, des modes de vie en général. En 1987, l'ONU a organisé une année internationale des sans-abri, et j'en ai été le responsable pour la France. L'Agence des Villes a été créée en 1978 ; j'y suis rentré en 1988 et y ai passé vingt-cinq années de ma vie. J'ai d'abord été responsable de l'Afrique francophone, puis de toute l'Afrique, puis de l’ensemble du monde en développement. Une expérience fantastique par les contacts humains dont j’ai pu bénéficier, sous toutes les latitudes.
“Nous pouvons être entendus et suivis, comme nous pouvons être magnifiquement ignorés.”
Au fond, à quoi sert l'Agence des Villes ?
Nous sommes des agitateurs. Le rôle central de l'Agence, c'est de conseiller, et d'essayer de convaincre. Nous sommes des experts en matière d'urbanisme et de développement urbain, et nous pouvons être entendus et suivis, comme nous pouvons être magnifiquement ignorés. Dès qu'une de nos recommandations est vécue comme une sérieuse remise en cause d'un équilibre social ou d’une hégémonie politique, alors elle souvent retoquée, mise au placard. Mais nous sommes perçus comme objectifs et neutres, sans intérêts commerciaux, et notre parole peut donc avoir plus de poids que celle des agences bilatérales.
Comment êtes-vous considérés à l'intérieur de l'ONU ?
A l'échelle de l'ONU, nous sommes une petite agence, et donc considérés comme tel... Je crois que nous sommes vus comme une sorte de « think tank » : on fait bouger les idées, on fait voter des résolutions, on organise des formations, on essaye de propager nos idées, nos expériences... Mais nous restons des experts, au sein d'une administration internationale. Nous devons être à l'écoute de l'avis des Etats membres, qu'il ne faut pas brusquer, tout en étant toujours un pas en avant. Pas trop loin en avant, pour ne pas risquer d'offusquer, mais un peu en avant tout de même pour faire progresser le monde.
En 2002, nous avons initié le Forum Urbain Mondial (FUM, ou WUF en anglais), qui réunit désormais 10 000 participants tous les deux ans. Le dernier s'est tenu à Naples, et le prochain a lieu ces jours-ci (du 5 au 11 avril) à Medellin, en Colombie. Entre le Forum Economique Mondial (FEM) de Davos d'un côté, et le Forum Social Mondial (FSM) né à Porto Alegre de l'autre, nous nous disions qu'il manquait un grand rendez-vous international pour tous ceux qui sur travaillent sur la question urbaine. Le FUM et ses débats sont devenus incontournables. Comme le FEM, le FUM réunit des leaders, des ministres, des maires, et comme le FSM il réunit des ONG et des activistes urbains. C’est une instance importante d’échanges et de propositions.
Combien d'employés l'agence compte-t-elle ?
A Nairobi, nous avons une équipe d'environ deux cents experts. Mais notre grande fierté, c'est d'avoir plus de personnel sur le terrain, dans les pays pauvres et les pays en crise. En Afghanistan, par exemple, nous avions à une époque vingt experts internationaux, qui ont recruté sur place jusqu'à mille Afghans pour travailler avec eux, les internationaux encadrant les locaux. Ensemble, il leur revenait de voir comment utiliser au mieux les crédits alloués dans les villages touchés par le conflit. Dans ce cas précis, j'ai souvenir d'une somme de 500 dollars par famille – des crédits en l'occurrence alloués par le Japon. Des montants modestes, d'où le besoin impérieux de les gérer au plus juste...
Il faut rappeler que, quand il s’agit de projets, les donations à l’ONU sont volontaires. Tel pays décide d'aider tel autre pays en difficulté. Une grosse partie de notre travail, c'est donc d'aller trouver des fonds pour pouvoir payer nos experts, qu’ils soient internationaux ou locaux. Ensuite, nous rendons des comptes aux Etats membres, sur tout : la transparence est totale, au dollar près. Hélas, les ressources affectées au développement sont en baisse continuelle depuis la fin de la guerre froide. Les pays riches se mobilisent pour l’action humanitaire – ils donnent pour les urgences, les camps de réfugiés, les casques bleus, les tsunamis... – et de moins en moins pour le développement.
Manifestation autour du park Gezy et de la place Taksim à Istanbul en juin 2013 (© Christophe Petit Tesson/MAXPPP)
Un souvenir marquant de sujet de satisfaction pour l'agence ?
En Chine, dans les années 1990, nous avons été entendus. Alors que sous Mao, l'urbanisation avait été totalement freinée, nous avons réussi à faire passer l'idée qu'il fallait au contraire la soutenir, et l'organiser, la guider. La Chine ayant d’énormes ressources, il lui était possible de faire entrer ses villes dans le XXIe siècle de manière réfléchie, structurée. Aux Chinois, nous avons aussi dit qu'ils devaient décentraliser les pouvoirs, donner de vrais moyens aux autorités locales, aux mairies, et ils ont suivi ces recommandations. Entre 1996 et 2010, nous avons énormément travaillé, dans le monde entier, pour promouvoir cette idée de renforcement des pouvoirs locaux et régionaux. Une charte sur la décentralisation a été rédigée et négociée, et a ensuite été adoptée partout dans le monde. A cette occasion, comme souvent, nous nous sommes faits les promoteurs d'une certaine philosophie du pouvoir, basée sur la démocratie participative.
L'année
2013 a été marquée par des soulèvements populaires dans plusieurs villes du
monde, notamment à Istanbul, et au Brésil. Quel lien voyez-vous entre ces
événements ?
D'abord, il y a le substrat social, et le fait qu'en Turquie comme au Brésil,
mais aussi en Grèce ou en Tunisie, beaucoup de jeunes adultes – les 25-30 ans –
ont atteint un bon niveau d'étude et de qualification et qu’ils ne trouvent pas
d’emplois à la hauteur de leurs attentes. Ensuite, à chaque fois, il y a eu un
enjeu environnemental : la destruction programmée d'un jardin public à
Istanbul, la privatisation d'espaces publics et le coût des transports à Rio et
Sao Paulo. Or, un projet qui passait à peu près discrètement il y a dix ou
vingt ans peut aujourd'hui être violemment rejeté – et tant mieux.
Les gens sont de plus en plus sensibles à leur cadre de vie, et s'organisent de mieux en mieux pour le défendre. Ajoutez à cela une défiance de plus en plus grande vis-à-vis du pouvoir politique, de la classe politique, et vous avez là un cocktail évidemment explosif, y compris dans notre pays. Les citadins n’attendent presque plus rien des politiques nationales mais s’impliquent dans les politiques locales qui touchent à leur quotidien. C’est la « glocalisation » qui marque notre époque, plus d’économie globale et plus de politique locale, et des cultures métisses.
Le 31/03/2014 à 21h59 _SOURCE WEB Par Emmanuel Tellier Telerama
Tags : L'Agence des Villes, c'est notre nom d'usage, mais le nom officiel, c'est ONU-Habitat (en anglais : UN-Habitat)... -Les gens sont de plus en plus sensibles à leur cadre de vie, et s'organisent de mieux en mieux pour le défendre - défiance de plus en plus grande vis-à-vis du pouvoir politique, de la classe politique, et vous avez là un cocktail évidemment explosif, y compris dans notre pays -Les citadins n’attendent presque plus rien des politiques nationales mais s’impliquent dans les politiques locales qui touchent à leur quotidien -glocalisation » qui marque notre époque, plus d’économie globale et plus de politique locale, et des cultures métisses-
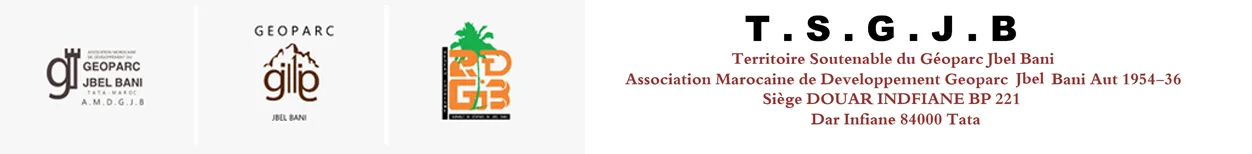

 vendredi 11 avril 2014
vendredi 11 avril 2014 0
0 



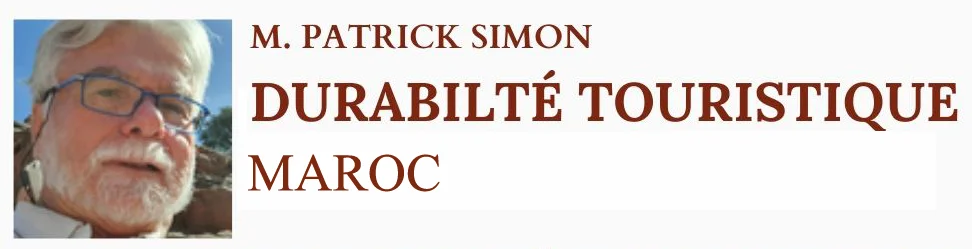







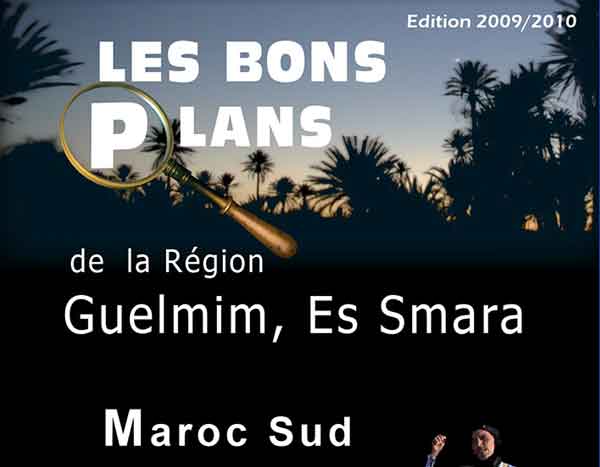






























 Découvrir notre région
Découvrir notre région