Salima Naji Sauveuse de l’oubli

L’architecte et anthropologue Salima Naji restaure des vieux monuments du Sud du Maroc. Elle redonne la mémoire aux Marocains, obsédés par l’Occident, oublieux de leur histoire et de leurs antiques gloires. Des costards, encore des costards. Toujours des ronds-de-cuir, suffocant sous le soleil dru d’Assa, s’étranglant avec leurs cravates. Inévitables, hélas, même dans cette petite ville du désert, fouettée par le vent. Heureusement, une apparition vient vite fendre cette platitude, cette uniformité humaine. Architecturale dans une veste africaine, un béret rétro et un pantalon de derviche. Patrimoniale, si j’ose dire. Je lorgne envieusement l’immense bijou en vieil argent qui pend à son cou. «C’est une fibule berbère. On l’utilise comme élément de protection dans certaines maisons, car elle symbolise la femme, la fécondité, la transmission», explique Salima Naji, le geste théâtral et la voix grave, cadencée. L’architecte voue un culte, une passion au patrimoine marocain. Si vaste, si «complet». Mais, hélas, si négligé, si méprisé. «Je n’ai pas vu ça au début. J’étais complètement éblouie. Parfois, il faut s’aveugler, éviter de voir certains freins, simplement se lancer». À l’époque, Salima Naji étudie avidement l’art à Paris et, quand elle le peut, sillonne gaiement l’immensité désertique ou montagneuse du Sud marocain. «J’avais devant moi des merveilles, à chaque fois. La richesse des décors, des tapisseries, des bijoux, des constructions me fascinait dans ces régions. En les examinant, j’ai réalisé que l’architecture était le contenant, la synthèse de tous les arts», s’émerveille la jeune femme, qui s’empresse de s’inscrire à l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-La-Villette. «La formation offrait une spécialisation en architectures vernaculaires (indigènes, ndlr) d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, de partout. Je ne me suis pas posé de questions». Commencent alors des échappées belles à Ouarzazate, Dadès, Tafilalet, Figuig, le Haut-Atlas… Des contrées que Salima Naji connaît depuis toujours. «Enfant, je voyageais beaucoup avec mon père, géomètre et topographe. Ma mère française adorait ces endroits, elle aussi. Cet amour-là m’a été transmis par eux deux. Nous allions chez les gens, spontanément, parce qu’il n’y avait pas d’hôtels à l’époque. Nous étions donc pleinement immergés dans l’atmosphère. Cette vie m’a permis de grandir, de me construire sans préjugés. Et, surtout, d’avoir envie de tout mettre en œuvre pour sauver le bâti de ces régions, mais aussi les hommes. Car derrière les bâtisses, il y a les humains, on l’oublie hélas trop souvent». Construire avec le peuple Voilà qui fait penser à Hassan Fathy (1900-1989), cet architecte égyptien qui entreprit de «construire avec le peuple» la Nouvelle Gurna, une cité édifiée grâce à des ressources exclusivement locales : des paysans-maçons formés sur le chantier et des matériaux de construction millénaires, comme la brique de boue. «Je m’inspire aussi du travail du Suisse Peter Zumthor et de l’Italien Renzo Piano. Ces grands architectes ont su allier hyper-modernité et techniques rustiques, venant de très loin», confie Salima Naji, passablement en rogne contre ces bâtisseurs de «neuf» «qui sont complètement à côté de la plaque et consomment énormément d’énergie. Le ciment, il faut le faire venir d’Agadir alors que nous avons, à portée de main, toutes sortes de techniques qui ont fait leurs preuves, qu’il faut réinvestir». Des techniques vernaculaires marocaines réputées écologiques comme le pisé, la pierre, le bois ou les stipes de palmier. «Je travaille à chaque fois avec les artisans locaux», insiste l’architecte-anthropologue, fermement résolue à sauver le plus de monuments traditionnels possibles, comme les Ksours d’Assa et d’Agadir Ouzrou. Mais ce qui subjugue la passionnée, ce sont les greniers-citadelles, des bâtiments communautaires fortifiés de l’Anti-Atlas, destinés à protéger des denrées comme l’orge, les amandes ou les noix d’argane. «J’y ai consacré ma thèse. J’essaie d’en restaurer un chaque année. Les fonds américains ont beaucoup aidé à réhabiliter les deux derniers greniers, des merveilles. J’interviens pour ma part à titre bénévole». Pour Salima Naji, chaque architecte marocain devrait, au moins une fois dans sa carrière, sauver un monument historique de l’oubli. «Nous serions dans un pays qui garderait ses composantes», martèle-t-elle. Un pays qui cesserait d’associer le progrès à l’Occident, systématiquement. Qui se dénigrerait moins, qui aurait moins honte de ce qu’il est. Qui recouvrerait des pans de sa mémoire, serait fier de ce qu’il fut, qui avancerait peut-être enfin. Un peuple sans histoire n’a pas de visage «J’ai peur que nous perdions cette civilisation des oasis. Que nous oubliions Sijlmassa, les royaumes juifs, les dynasties, almoravide, almohade, saadienne. Ce serait une grande perte, une perte civilisationnelle». L’anthropologue aime à rappeler l’exemple des façades de maisons dites «marocaines» à Djenné, à quelque 370 kilomètres de Bamako. Un souvenir du règne d’Al-Mansour Ad-Dahbi, cette époque où le Maroc s’étendait jusqu’à l’actuel Mali. «Un peuple sans histoire n’a pas de visage, comme on dit. Il faut toujours savoir d’où on vient et où on va». Sur son blog, Salima Naji pousse un coup de gueule mémorable contre des «architectes de Casablanca». «J’ai découvert que ces splendides régions où je travaille étaient pour eux “misérabilistes”. Pour eux, présenter des traditions constructives (revisitées) de notre pays donnerait l’image d’un pays “tiers-mondiste”, etc. Mais qu’est-ce que c’est que cette vision post-coloniale de cerveaux traumatisés par une illusion du progrès par les matériaux ? Cerveaux acculturés qui ne connaissent pas leur propre pays ?» Mais la jeune femme ne s’attarde pas beaucoup sur ces vaines opinions. «Je suis en train de restaurer le minaret d’Akka avec le ministère de la culture. Je travaille beaucoup sur Tiznit aussi. Mes projets sont transversaux, ils touchent à la culture, au développement local et bien sûr à l’architecture locale». Et n’allez pas lui dire qu’elle restaure des monuments traditionnels par nostalgie. «Je ne cherche pas à figer le passé. Je ne suis pas enfermée. Mon approche n’est pas romantique mais responsable. J’ai la chance d’être dans un pays qui a une immense richesse. On peut garder le passé et être dans une grande modernité. On le fait déjà très bien pour le caftan, la cuisine ou le tadelakt. Pourquoi pas pour l’architecture ?». Brièvement : Salima Naji - 1971 : Naissance à Rabat. - 2003 : Décroche son diplôme d’architecte à l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris La Villette. - 2004 : Démarre le projet de restauration des ksours et greniers collectifs du Sud marocain. - 2010 : Honorée par la cérémonie du Takrim de l’ordre des architectes du Royaume. - 2013 : Poursuit son aventure patrimoniale, régulièrement racontée sur le site www.salimanaji.org. SOURCE WEB Par Sana Guessous. La Vie éco
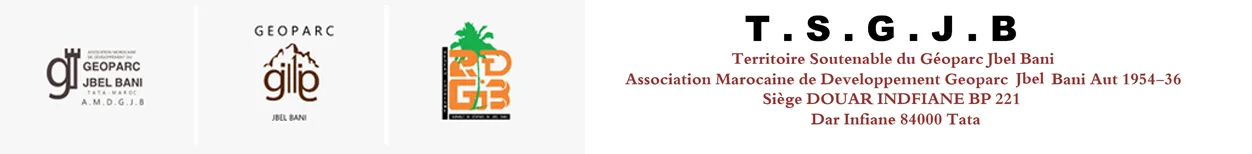

 mercredi 13 février 2013
mercredi 13 février 2013 0
0 



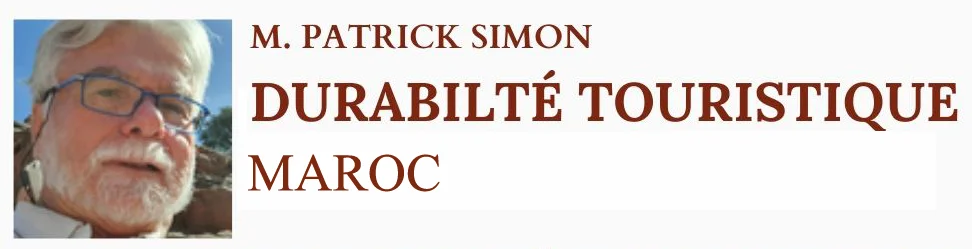







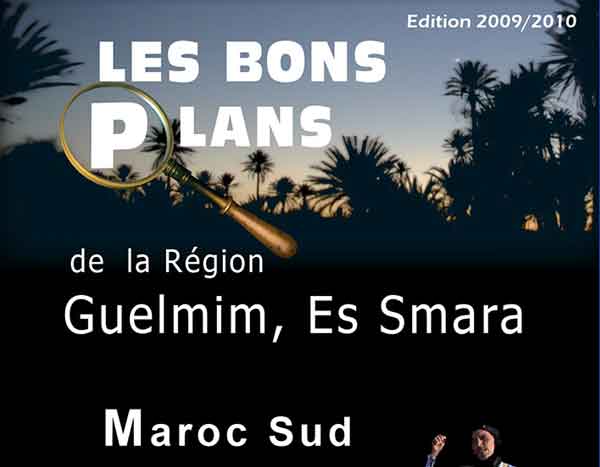






























 Découvrir notre région
Découvrir notre région