Entretien avec Salima Naji, membre du comité scientifique du Musée berbère du jardin Majorelle à Marrakech

«Ce musée voudrait rendre hommage aux premiers habitants du Maroc à la fois africains et méditerranéens»
Salima Naji, membre du comité scientifique, avec le professeur Ahmed Skounti, du Musée berbère du jardin Majorelle à Marrakech, décrit et commente le premier colloque annuel : «Reconnaître et valoriser : le Musée berbère du jardin Majorelle, un musée ouvert sur le monde».
«Les échanges ne sont vraiment fructueux que lorsqu’ils s’appuient sur un dialogue véritable».
Le Matin : En inaugurant le nouveau Musée berbère du jardin Majorelle, le 3 décembre dernier, Pierre Bergé avait fait cette déclaration : «Depuis mon arrivée à Marrakech en 1966, disait-il, je n’ai cessé d’être fasciné par la culture et l’art berbères. Au cours des années, j’ai collectionné, admiré cet art qui s’étend sur plusieurs pays à la fois. À juste titre, les Berbères ont toujours été fiers de leur culture qu’ils n’ont cessé de revendiquer malgré les vicissitudes qu’ils rencontraient. À Marrakech, terre berbère, dans le jardin Majorelle, créé par un artiste qui a peint tant de scènes, d’hommes et de femmes berbères, c’est naturellement que l’idée de ce Musée s’est imposée.» L’Institut français a organisé à Marrakech la semaine dernière une rencontre sur le thème : «Les Berbères aujourd’hui au Maroc», que vous avez animée avec d’autres intellectuels. Quel est votre ressenti au sujet de ce musée ?
Salima Naji : Le très beau musée berbère de Pierre Bergé est un projet quasi unique au monde : il existe beaucoup de musées d’art islamique dans le monde, de nombreux musées des arts dits «premiers», plusieurs collections d’art asiatique admirables, mais a-t-on des musées rendant hommage à la culture berbère ? Très peu, malheureusement, dans le monde comme dans le Royaume, il n’existe qu’une poignée de musées, partiels, souvent maladroits, rarement scientifiques. Alors que cette civilisation, qui représente à la fois nos racines et le creuset dans lequel nous continuons à nous mouvoir, est infiniment subtile et diverse. En Afrique du Nord, et au Maroc en particulier, c’est aux Imazighen, ces «Proto-Méditerranéens» dont la présence est attestée depuis plus de 9000 ans, que ce musée voudrait rendre hommage : aux premiers habitants de notre pays, à la fois africains et méditerranéens, mais en l’ancrant dans le monde d’aujourd’hui.
Installée dans l’atelier conçu par Paul Sinoir en 1931 pour Jacques Majorelle, dans le jardin qui porte le nom de ce dernier, la collection personnelle de Pierre Bergé et de Yves Saint Laurent a enfin été présentée au public en décembre dernier. Cet écrin splendide qui a tous les artefacts de la culture matérielle amazighe ne s’arrête pourtant pas aux objets, mais voudrait également présenter, très régulièrement, la culture immatérielle et tous ceux qui font ou façonnent notre culture.
C’est dans ce contexte qu’a été organisé le premier colloque du Musée berbère du jardin Majorelle, hors les murs. Une façon intelligente de prolonger et d’enrichir la collection exposée au musée. L’idée de Pierre Bergé, l’initiateur et président de la Fondation Majorelle avec Madison Cox, son vice-président, a été de proposer un double volet : d’un côté, une exposition à thème, à chaque fois renouvelée, et, de l’autre, des événements dignes d’un grand musée international, avec une revue et des laboratoires de recherche spécialisés associés.
Un projet culturel, c’est une démarche, ce sont des actions comme la création du musée, l’organisation de ce colloque et c’est surtout une circulation des idées à travers des outils, la communication et, spécialement, le partage. Peut-on considérer que le colloque sera un rendez-vous culturel annuel ?
M. Bergé l’a clairement énoncé en ouverture du premier colloque : comment peut-il rendre hommage à ce pays qui l’a si bien accueilli et qui lui a tant apporté ? Quoi apporter que le Royaume n’aurait pas, mais qui lui appartiendrait intrinsèquement ? Et pour ce grand homme de culture, tout naturellement, s’est imposée cette idée de partage culturel. Les échanges ne sont vraiment fructueux que lorsqu’ils s’appuient sur un dialogue véritable, la recherche d’une réciprocité de regards entre les cultures. Il y a eu le jardin Majorelle, connu mondialement (600 000 visiteurs par an !), acquis en 1980 par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé pour le préserver d’un projet immobilier. Ensuite, la Fondation, créée en 2001, dans le but de sauvegarder le patrimoine écologique, historique et culturel du jardin Majorelle, qui a été reconnu d’utilité publique par décret en 2011. Les profits qui sont dégagés soutiennent d’autres projets au Maroc.
Désormais, toujours selon cette idée d’ouvrir la culture aux autres, une rencontre se tiendra désormais annuellement, l’occasion de lancer le premier «Cahier du Musée berbère», une publication scientifique dont l’objectif est d’accompagner la connaissance et le rayonnement de cette culture qui est présente sous nos yeux au quotidien, mais qui, paradoxalement, reste encore à découvrir pour beaucoup. La publication, en anglais, rayonnera ainsi dans tous les musées et les institutions spécialisées du monde pour mieux faire connaître la richesse de notre pays et de la tamazgha ou aire culturelle amazighe, mais aussi la judaïté marocaine ou d’autres traits culturels qui témoignent d’une ouverture constante de notre pays, carrefour civilisationnel et culturel, au nord comme au sud, par terre (commerce transsaharien), comme par mer (enclaves portugaises, ports sultaniens de l’Oued Noun ou d’Essaouira, etc.). Aussi, pour l’ouverture du colloque, avec Björn Dahlström, le conservateur du musée Majorelle, avons-nous, Ahmed Skounti et moi-même, voulu proposer au public un aperçu sur la contemporanéité entre l’héritage, vaste et riche, qui est présenté dans les salles du musée, et le présent, fertile, en conviant à ce premier Symposium des intervenants de grande qualité.
La journée s’est donc déroulée en trois temps, pouvez-nous en dire plus ?
La journée était organisée sous forme de tables rondes, de conférences et de projections. M. Bergé a ouvert le colloque, en présence de plusieurs personnalités du monde de la culture et de celle du ministre des Habous, natif du Haut-Atlas, Ahmed Taoufiq. Pierre Bergé a parlé de la genèse du projet depuis 1966 où, avec Yves Saint Laurent, ils découvrent, éblouis, Marrakech et la richesse de son arrière-pays. Et puis, il a rappelé les dates, toutes symboliques, de cette connaissance progressive de la civilisation marocaine et où peu à peu, comme une évidence, s’esquisse le projet du musée :
«À Marrakech, terre berbère, dans le jardin Majorelle, créé par un artiste qui a peint tant de scènes, d’hommes et de femmes berbères, qui, dès les années 1930, allait peindre les casbahs dans les hautes vallées de l’Atlas».
D’un côté, il y a une vie de collecte et d’admiration pour notre civilisation, de l’autre, une attention particulière qu’il a eue pour une culture longtemps minorisée et pas assez reconnue, jusqu’à ce que soit portée création de l’Institut royal de la culture amazighe par le souverain en 2001. Pierre Bergé a ainsi évoqué le fameux discours du 9 mars 2011 et a cité les propos mêmes du Souverain : «La pluralité de l’identité marocaine unie et riche de la diversité de ses affluents, et au cœur de laquelle figure l’amazighité, patrimoine commun de tous les Marocains», en faisant référence à la nouvelle Constitution marocaine, adoptée en juillet 2011, qui officialise la langue amazighe et le Maroc comme le Royaume de la diversité reconnue.
La table ronde, le second temps fort de cette journée, a décliné les multiples dimensions de la civilisation berbère avec ses savoir-faire et ses savoir-être matériels et immatériels ? Qu’en avez-vous retenu ?
Le second temps a en effet présenté une table ronde, intitulée «les Berbères au Maroc : histoire, langue et culture», animée par notre grand expert de l’Unesco et homme d’engagement, Ahmed Skounti, enseignant chercheur à l’INSAP de Rabat qui avait réuni à ses côtés Ahmed Assid, chercheur à l’IRCAM à Rabat et El Mehdi Iâzzi, enseignant chercheur à l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Les propos étaient complémentaires : à partir des grandes lignes de notre héritage, tous trois ont fait le point sur «ceux qui ont fait et qui font» que ce pays est ce qu’il est dans toutes ses composantes mêlées. Ahmed Skounti a parlé d’une culture à deux versants qui peuvent être parfois considérés comme antinomiques, mais qui sont en réalité complémentaires, comme les «versants d’une montagne qui semblent s’opposer». Or il n’en est rien. Par des exemples pris depuis la plus haute Antiquité (Juba II et son fils Ptolémée, par exemple), aux grands monuments produits par les grandes dynasties marocaines, toutes ancrées dans les profondeurs du Sud, du Noun au Haut-Dra, jusqu’au Tafilalet, le limon est le même qui continue à fabriquer un dialogue de références mêlées. «De ce point de vue, a-t-il conclu en analysant notre civilisation, qui a connu une plasticité extraordinaire en s’adaptant à toutes les formes du pouvoir, la berbérité, et sa forme moderne ou contemporaine, la marocanité, est une synthèse», une synthèse d’apports multiples autochtones, allochtones par les influences des cultures qui ont mouillé nos rivages, méditerranéen, atlantique ou saharien, «la berbérité lato sensu», celle qui porte en elle une conception ouverte de la culture, «hellénique, puis latine versus berbéro-punique dans l’Antiquité ; andalouse versus berbéro-musulmane depuis le Moyen-âge ; européanisée, franco-hispano-américaine versus berbéro-arabo-musulmane depuis le XXe siècle. Un même peuple scindé en deux depuis la plus haute Antiquité est ainsi présent sur le même territoire : les termes ont certes changé, le contexte historique et culturel aussi, mais progressivement les apports culturels exogènes étaient coulés dans un moule local qui en digérait la chair et en adaptait l’esprit à sa guise».
Avec les talents d’orateurs qu’on lui connaît, Ahmed Assid – qui avait un public venu tout exprès pour l’écouter – a parlé du mouvement culturel amazigh depuis la colonisation jusqu’à aujourd’hui, avec des dates douloureuses, des conquêtes symboliques, fortes, des avancées et des reculs, jusqu’à la Constitution. Avec beaucoup de distanciation, d’humour et de générosité, il a continué sur sa lancée dans un discours d’ouverture, sans langue de bois ni communautarisme, en mettant en valeur les différents acteurs qui ont fait, ces toutes dernières années, la conquête d’une reconnaissance enfin admise. On ne peut en quelques mots relater toute l’épopée retracée, mais son propos venait compléter le premier, tandis le linguiste, El Mehdi Iâzzi, a voulu présenter la langue amazighe, du Niger au Maroc, des contreforts atlantiques marocains à l’enclave de Siwa en Égypte, mais aussi de tous les pays d’immigration où la dynamique de la langue est indéniable.
Une façon de faire en quelque sorte le tour du monde des langues berbères, des langues maternelles aux langues normées modernes. L’intérêt de cette table ronde a été non pas de creuser des frontières, d’enfermer des Hommes et des territoires, mais au contraire, en montrant les flux et les reflux d’un legs complexe, qui ne se résume pas à des conflits de générations ou à des chasses gardées, mais où il s’agit bien d’une culture donnée en partage.
Cette culture «donnée en partage» a été très présente dans les projections et les débats qui ont suivi, animés par un auditoire très fourni ?
Oui. Ce fut une journée riche en effet où personne ne s’est lassé, les questions fusaient dans les débats et les conversations se prolongeaient sur le parvis de l’Institut français après les deux projections si émouvantes qui clôturaient la journée. Ahmed Skounti avait voulu que soit projeté «Quand le soleil fait tomber les moineaux», une fiction émouvante de Hassan Legzouli (1999, 38 minutes) qui retrace l’idée de la perte de ces grands enfants, partis à la conquête de la modernité. Je voulais pour ma part que soit exposé ce projet «Histoire tatouée, Bougafer 33», documentaire historique de Ahmed Baidou et Mustapha El Qadery (2010, 52 minutes). Mustapha El Qadery, enseignant chercheur à l’Université Mohammed V à Rabat, en a fait une courte présentation : «Voyage dans le temps et dans l’espace, “Bougafer 33” restitue les souvenirs et les lieux d’une bataille survenue en 1933 entre l’armée française et les Aït Atta, dans le sud-est marocain, durant la guerre du Maroc lors de la conquête coloniale franco-espagnole». Il a expliqué la genèse du projet, la perte des témoins que l’âge rattrape.
Vous avez, de votre côté, animé «L’art de bâtir berbère, monuments anciens et biens collectifs actuels». Une présentation des campagnes de restauration que vous avez coordonnées dans le sud du Royaume et des enjeux de la préservation des architectures et des procédés constructifs berbères. Un mot sur ce moment d’une densité particulière ?
Entre ces deux moments, j’ai projeté près de 500 diapositives des sites que j’ai restaurés depuis 2004, en montrant la spécificité de ma démarche participative, où j’ai essayé de sauver – en accord avec la population locale – des sites de magnifiques «igudars» ou greniers de l’Anti-Atlas, le beau Qsar d’Assa, dont la restauration nous a été confiée à partir de 2006 par l’Agence du Sud, ainsi que le village fortifié d’Agadir Ouzrou (en cours de restauration), mais aussi et enfin de vénérables mosquées rurales du Haut-Atlas, etc.
Des «idebnam», sépultures néolithiques du monde berbère, appelées aussi plus tardivement «taghremt» jusqu’aux «tighremts» ou citadelles (casbahs) plus récentes, des «ribat» aux villes médiévales dynastiques, des «igudars» sacrés (greniers collectifs) aux zawiyas (tombeau-mosquée), il est souvent difficile de faire la part des permanences et des influences appartenant à cette belle architecture amazighe, immémoriale, maintenue de longue date jusqu’à nous. D’autant que par une ironie de l’histoire, ces dix dernières années se sont accompagnées d’un «développement local» sans précédent, nécessaire pour les routes et les services (eau, électricité), mais trop souvent hâtif pour le patrimoine, et qui a précipité de trop nombreuses destructions.
Quelques indices cependant sont donnés par une archéologie novatrice insérée dans le réseau comparatif des grandes routes commerciales (terre et mer) et s’appuyant sur des découvertes matérielles récentes qui viennent enrichir toute approche comparative des bâtiments existants encore, comme des techniques constructives contemporaines. En tant qu’architecte ayant relevé pour les restaurer de vénérables bâtiments dont l’intérêt résidait essentiellement dans leurs architectoniques particulières (Atlas et vallées présahariennes).
En tant qu’anthropologues, nous voulions présenter notre approche, éminemment transversale, participative, se construisant auprès des acteurs dans diverses situations.
Il est intéressant de s’attarder sur les enjeux de la protection du patrimoine à partir d’actions concrètes en partant du présupposé que le patrimoine est une nécessité et non un luxe, dans le contexte particulier d’un État qui, certes, a des priorités (santé, éducation) non négociables, mais où il est possible de sauvegarder le patrimoine par une politique de sensibilisation et de formation aux techniques vernaculaires. Nous ne manquerons pas de nous attarder sur la réalité sociale de populations qui ont perdu toute confiance culturelle dans leur histoire et dans certaines de leurs traditions. En effet, l’écrasante majorité du patrimoine marocain est la propriété de particuliers ou de communautés rurales qui vont très rapidement, dans les prochaines années, prendre la décision de conserver ou de détruire leur mémoire. Une éthique de la préservation s’impose et doit être largement diffusée.
________________________________________
Biographie de Salima Naji
Docteur en anthropologie sociale (École des hautes études en sciences sociales, Paris), diplômée du Laboratoire de troisième cycle Arts, esthétiques, sciences et technologies de l’image (Paris VIII), Salima Naji est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence sur les architectures vernaculaires du Sud marocain. Elle est particulièrement investie dans le sauvetage du patrimoine bâti, elle a restauré plusieurs architectures majeures (casbahs, greniers collectifs de l’Anti-Atlas, mosquées rurales) et l’ensemble du ksar d’Assa.
Architecte DPLG (École d’architecture de Paris-La-Villette), Salima Naji exerce son métier d’architecte en explorant les procédés constructifs ancestraux, qu’elle perfectionne et réadapte à des usages contemporains, résolument ancrés dans le développement durable. Pisé, pierre, bois, stipes de palmier ou d’autres fibres : toutes les techniques mixtes des traditions vernaculaires du Maroc sont ainsi réinvesties dans une construction écologique sublimant le geste de l’artisan.
Prix Jeunes architectes, de la Fondation EDF en 2004, Inspiring women, expanding Horizon par la Mosaic Foundation à Washington en 2008, la cérémonie du Takrim par l’Ordre des architectes du Royaume en 2010, et Prix Holcim du développement durable, 2011, Catégorie bronze Afrique-Moyen-Orient.
Publié le : 20 Mai 2012 –
SOURCE WEB par Farida Moha, LE MATIN
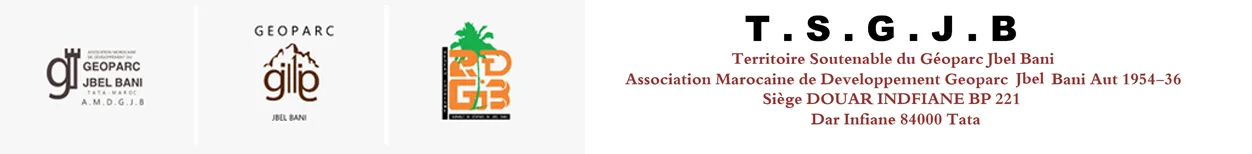

 jeudi 7 juin 2012
jeudi 7 juin 2012 0
0 



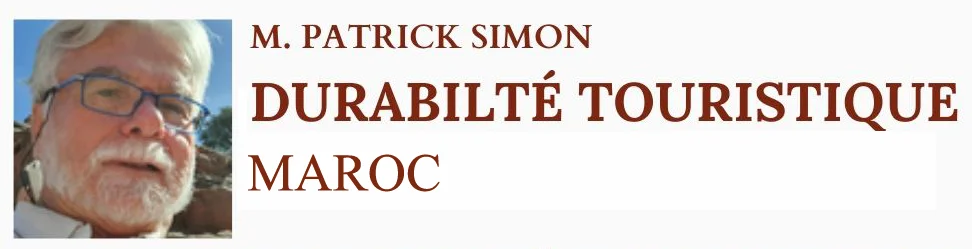







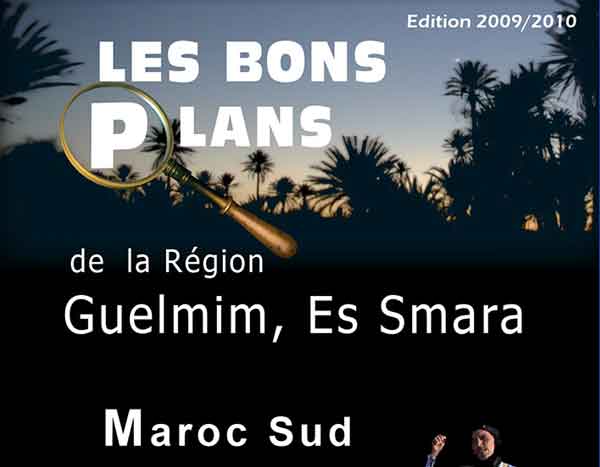






























 Découvrir notre région
Découvrir notre région